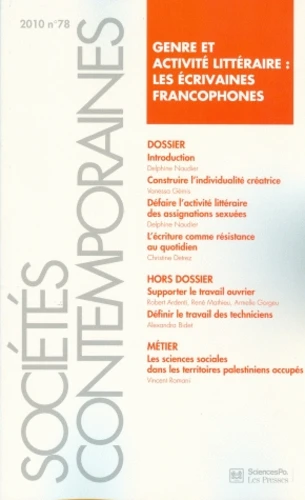Sociétés contemporaines N° 78, 2010
Genre et activité littéraire : les écrivains francophones
Par : , , , Formats :
Actuellement indisponible
Cet article est actuellement indisponible, il ne peut pas être commandé sur notre site pour le moment. Nous vous invitons à vous inscrire à l'alerte disponibilité, vous recevrez un e-mail dès que cet ouvrage sera à nouveau disponible.
- Nombre de pages167
- PrésentationBroché
- Poids0.295 kg
- Dimensions15,5 cm × 25,0 cm × 1,0 cm
- ISBN978-2-7246-3193-7
- EAN9782724631937
- Date de parution16/07/2010
- ÉditeurSciences Po (Les Presses de)
Résumé
Ce dossier " Genre et activité littéraire : les écrivaines francophones " s'est attaché aux expériences d'écrivaines installées en Algérie, en Belgique, en France et au Maroc durant deux périodes historiques : la fin du XIXe siècle et le tournant du XXe siècle. Malgré les disparités propres à chaque contexte géographique et historique, le rapport social de genre persiste. En effet, si les écrivaines appartiennent généralement aux élites sociales et culturelles, il apparaît néanmoins qu'écrire de la littérature et la publier n'est pas une activité " qui va de soi ".
Dès lors comment les écrivaines font-elles pour réaliser leurs aspirations littéraires et construire leur individualité créatrice dans le monde du privé comme dans le champ littéraire ? En sortant les manuscrits du tiroir et en les publiant, elles font évoluer les normes de genre. Ainsi, qu'il s'agisse de se défaire des assignations sexuées, de résister au quotidien en franchissant les obstacles matériels et symboliques pour gagner de la confiance en soi, leur capacité d'agir se déploie aussi dans le monde des lettres.
Et leur " participation effective " à la vie littéraire se traduit par la création de réseaux féminins et contribue à institutionnaliser les lettres féminines malgré leur faiblesse numérique et symbolique.
Dès lors comment les écrivaines font-elles pour réaliser leurs aspirations littéraires et construire leur individualité créatrice dans le monde du privé comme dans le champ littéraire ? En sortant les manuscrits du tiroir et en les publiant, elles font évoluer les normes de genre. Ainsi, qu'il s'agisse de se défaire des assignations sexuées, de résister au quotidien en franchissant les obstacles matériels et symboliques pour gagner de la confiance en soi, leur capacité d'agir se déploie aussi dans le monde des lettres.
Et leur " participation effective " à la vie littéraire se traduit par la création de réseaux féminins et contribue à institutionnaliser les lettres féminines malgré leur faiblesse numérique et symbolique.
Ce dossier " Genre et activité littéraire : les écrivaines francophones " s'est attaché aux expériences d'écrivaines installées en Algérie, en Belgique, en France et au Maroc durant deux périodes historiques : la fin du XIXe siècle et le tournant du XXe siècle. Malgré les disparités propres à chaque contexte géographique et historique, le rapport social de genre persiste. En effet, si les écrivaines appartiennent généralement aux élites sociales et culturelles, il apparaît néanmoins qu'écrire de la littérature et la publier n'est pas une activité " qui va de soi ".
Dès lors comment les écrivaines font-elles pour réaliser leurs aspirations littéraires et construire leur individualité créatrice dans le monde du privé comme dans le champ littéraire ? En sortant les manuscrits du tiroir et en les publiant, elles font évoluer les normes de genre. Ainsi, qu'il s'agisse de se défaire des assignations sexuées, de résister au quotidien en franchissant les obstacles matériels et symboliques pour gagner de la confiance en soi, leur capacité d'agir se déploie aussi dans le monde des lettres.
Et leur " participation effective " à la vie littéraire se traduit par la création de réseaux féminins et contribue à institutionnaliser les lettres féminines malgré leur faiblesse numérique et symbolique.
Dès lors comment les écrivaines font-elles pour réaliser leurs aspirations littéraires et construire leur individualité créatrice dans le monde du privé comme dans le champ littéraire ? En sortant les manuscrits du tiroir et en les publiant, elles font évoluer les normes de genre. Ainsi, qu'il s'agisse de se défaire des assignations sexuées, de résister au quotidien en franchissant les obstacles matériels et symboliques pour gagner de la confiance en soi, leur capacité d'agir se déploie aussi dans le monde des lettres.
Et leur " participation effective " à la vie littéraire se traduit par la création de réseaux féminins et contribue à institutionnaliser les lettres féminines malgré leur faiblesse numérique et symbolique.