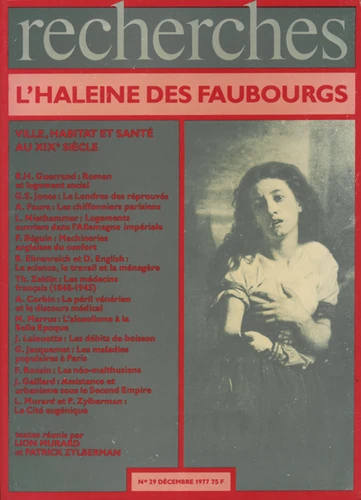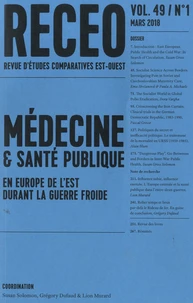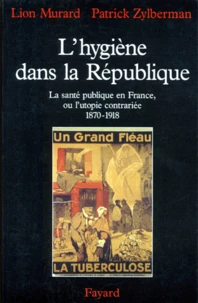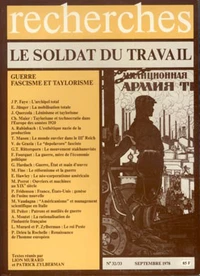Recherches N° 29, décembre 1977
L'haleine des faubourgs. Ville, habitat et santé au XIXe siècle
Par : , Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 26 juillet et le 29 juilletCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 3 à 6 jours après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 26 juillet et le 29 juillet
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages468
- PrésentationBroché
- Dimensions15,5 cm × 21,5 cm × 0,0 cm
- ISBN2-86222-045-0
- EAN9782862220451
- Date de parution01/01/1978
- ÉditeurRecherches éditions
Résumé
Le logement populaire a-t-il été exploré dans ses sentines les plus infâmes ? – demande R.H. Guerrand. La littérature, et particulièrement les romanciers populaires du XlXe siècle (E. Sue, H. Malot, E. Zola) ne constitue-t-elle pas une approche excitante, suggestive autant que les sources non littéraires ? On sait bien que les énoncés se relancent à travers le roman, la littérature sociale, les enquêtes et les manifestes.
L'histoire des villes n'est-elle pas àchercher en dehors de l'histoire de l'architecture, de la description répétitive des modèles et des types d'habitats ? Du côté des politiques de salubrité par exemple. Ou bien du côté du logement comme expérience prolétarienne. Les villes, c'est aussi l'histoire des pauvres – de la malpropreté des masses sans toit ni loi, de l'apparition d'une population que la crainte des classes dirigeantes assignera à la « dégénérescence » lorsque la charité transmettra ses pouvoirs à l'hygiène sociale.
Les villes, ce peut être enfin l'Histoire de l'intimité : l'hygiéniste s'introduit dans la famille pour l'éduquer à l'« organisation scientifique » du travail domestique. Mais la santé a de multiples façons de se répandre dans le corps des cités et à l'intérieur des familles : il faudra d'abord connaître le véritable mouvement de la profession médicale au cours de ce siècle ; considérer ensuite les campagnes contre les fléaux sociaux, contre l'alcoolisme et la propagation des débits de boisson.
Contributions de Beguin (F.), Corbin (A.), Ehrenreich (B.), English (D.), Faure (A.), Gareth Jones (S.), Guerrand (Roger-Henri), Jacquemet (G.), Lalouette (J.), Marrus (A.), Niethammer (L.), Ronsin (F.), Zeldin (Th.)
L'histoire des villes n'est-elle pas àchercher en dehors de l'histoire de l'architecture, de la description répétitive des modèles et des types d'habitats ? Du côté des politiques de salubrité par exemple. Ou bien du côté du logement comme expérience prolétarienne. Les villes, c'est aussi l'histoire des pauvres – de la malpropreté des masses sans toit ni loi, de l'apparition d'une population que la crainte des classes dirigeantes assignera à la « dégénérescence » lorsque la charité transmettra ses pouvoirs à l'hygiène sociale.
Les villes, ce peut être enfin l'Histoire de l'intimité : l'hygiéniste s'introduit dans la famille pour l'éduquer à l'« organisation scientifique » du travail domestique. Mais la santé a de multiples façons de se répandre dans le corps des cités et à l'intérieur des familles : il faudra d'abord connaître le véritable mouvement de la profession médicale au cours de ce siècle ; considérer ensuite les campagnes contre les fléaux sociaux, contre l'alcoolisme et la propagation des débits de boisson.
Contributions de Beguin (F.), Corbin (A.), Ehrenreich (B.), English (D.), Faure (A.), Gareth Jones (S.), Guerrand (Roger-Henri), Jacquemet (G.), Lalouette (J.), Marrus (A.), Niethammer (L.), Ronsin (F.), Zeldin (Th.)
Le logement populaire a-t-il été exploré dans ses sentines les plus infâmes ? – demande R.H. Guerrand. La littérature, et particulièrement les romanciers populaires du XlXe siècle (E. Sue, H. Malot, E. Zola) ne constitue-t-elle pas une approche excitante, suggestive autant que les sources non littéraires ? On sait bien que les énoncés se relancent à travers le roman, la littérature sociale, les enquêtes et les manifestes.
L'histoire des villes n'est-elle pas àchercher en dehors de l'histoire de l'architecture, de la description répétitive des modèles et des types d'habitats ? Du côté des politiques de salubrité par exemple. Ou bien du côté du logement comme expérience prolétarienne. Les villes, c'est aussi l'histoire des pauvres – de la malpropreté des masses sans toit ni loi, de l'apparition d'une population que la crainte des classes dirigeantes assignera à la « dégénérescence » lorsque la charité transmettra ses pouvoirs à l'hygiène sociale.
Les villes, ce peut être enfin l'Histoire de l'intimité : l'hygiéniste s'introduit dans la famille pour l'éduquer à l'« organisation scientifique » du travail domestique. Mais la santé a de multiples façons de se répandre dans le corps des cités et à l'intérieur des familles : il faudra d'abord connaître le véritable mouvement de la profession médicale au cours de ce siècle ; considérer ensuite les campagnes contre les fléaux sociaux, contre l'alcoolisme et la propagation des débits de boisson.
Contributions de Beguin (F.), Corbin (A.), Ehrenreich (B.), English (D.), Faure (A.), Gareth Jones (S.), Guerrand (Roger-Henri), Jacquemet (G.), Lalouette (J.), Marrus (A.), Niethammer (L.), Ronsin (F.), Zeldin (Th.)
L'histoire des villes n'est-elle pas àchercher en dehors de l'histoire de l'architecture, de la description répétitive des modèles et des types d'habitats ? Du côté des politiques de salubrité par exemple. Ou bien du côté du logement comme expérience prolétarienne. Les villes, c'est aussi l'histoire des pauvres – de la malpropreté des masses sans toit ni loi, de l'apparition d'une population que la crainte des classes dirigeantes assignera à la « dégénérescence » lorsque la charité transmettra ses pouvoirs à l'hygiène sociale.
Les villes, ce peut être enfin l'Histoire de l'intimité : l'hygiéniste s'introduit dans la famille pour l'éduquer à l'« organisation scientifique » du travail domestique. Mais la santé a de multiples façons de se répandre dans le corps des cités et à l'intérieur des familles : il faudra d'abord connaître le véritable mouvement de la profession médicale au cours de ce siècle ; considérer ensuite les campagnes contre les fléaux sociaux, contre l'alcoolisme et la propagation des débits de boisson.
Contributions de Beguin (F.), Corbin (A.), Ehrenreich (B.), English (D.), Faure (A.), Gareth Jones (S.), Guerrand (Roger-Henri), Jacquemet (G.), Lalouette (J.), Marrus (A.), Niethammer (L.), Ronsin (F.), Zeldin (Th.)