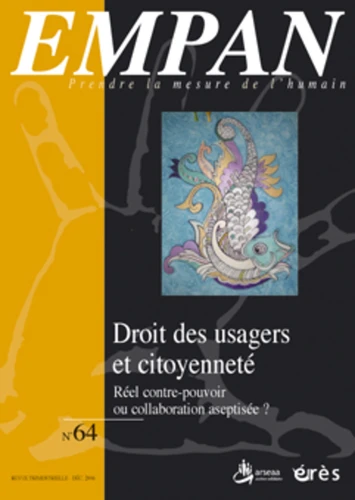Empan N° 64
Droit des usagers et citoyenneté. Réel contre-pouvoir ou collaboration aseptisée ?
Par : , , , Formats :
Actuellement indisponible
Cet article est actuellement indisponible, il ne peut pas être commandé sur notre site pour le moment. Nous vous invitons à vous inscrire à l'alerte disponibilité, vous recevrez un e-mail dès que cet ouvrage sera à nouveau disponible.
- Nombre de pages164
- PrésentationBroché
- Poids0.295 kg
- Dimensions17,0 cm × 24,0 cm × 1,0 cm
- ISBN978-2-7492-0631-8
- EAN9782749206318
- Date de parution05/04/2007
- ÉditeurErès
Résumé
Les modèles des nouvelles politiques sociales évoluent : loi du 29 juillet 1998, de lutte contre les exclusions, nouvelles formes d’indemnisation du chômage et loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Sous l’influence des politiques anglo-saxonnes, la consécration des droits de la personne (cf. Art. 7 de la loi 2002.
02 rénovant l’action sociale et médico-sociale), les politiques de droit commun, le «mainstreaming», le paradigme de l’usager sont à la mode. Le secteur social et médico-social est un des derniers à faire, en droit, à l’usager une nouvelle place et celle-ci obéit à deux principes : participation et transparence. Elle oblige les établissements à s’interroger sur leurs pratiques. Ceux-ci doivent faire émerger cette nouvelle «citoyenneté» dans les différentes acceptions du terme, tout en protégeant ces personnes souvent «vulnérables», aux yeux de la loi.
Dans le rapport étroit entre droit des usagers et citoyenneté, que deviennent les questions relatives à la négociation, au consentement éclairé, au contrat ? Les certitudes de l’action unilatérale sont-elles remises en cause ?
02 rénovant l’action sociale et médico-sociale), les politiques de droit commun, le «mainstreaming», le paradigme de l’usager sont à la mode. Le secteur social et médico-social est un des derniers à faire, en droit, à l’usager une nouvelle place et celle-ci obéit à deux principes : participation et transparence. Elle oblige les établissements à s’interroger sur leurs pratiques. Ceux-ci doivent faire émerger cette nouvelle «citoyenneté» dans les différentes acceptions du terme, tout en protégeant ces personnes souvent «vulnérables», aux yeux de la loi.
Dans le rapport étroit entre droit des usagers et citoyenneté, que deviennent les questions relatives à la négociation, au consentement éclairé, au contrat ? Les certitudes de l’action unilatérale sont-elles remises en cause ?
Les modèles des nouvelles politiques sociales évoluent : loi du 29 juillet 1998, de lutte contre les exclusions, nouvelles formes d’indemnisation du chômage et loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Sous l’influence des politiques anglo-saxonnes, la consécration des droits de la personne (cf. Art. 7 de la loi 2002.
02 rénovant l’action sociale et médico-sociale), les politiques de droit commun, le «mainstreaming», le paradigme de l’usager sont à la mode. Le secteur social et médico-social est un des derniers à faire, en droit, à l’usager une nouvelle place et celle-ci obéit à deux principes : participation et transparence. Elle oblige les établissements à s’interroger sur leurs pratiques. Ceux-ci doivent faire émerger cette nouvelle «citoyenneté» dans les différentes acceptions du terme, tout en protégeant ces personnes souvent «vulnérables», aux yeux de la loi.
Dans le rapport étroit entre droit des usagers et citoyenneté, que deviennent les questions relatives à la négociation, au consentement éclairé, au contrat ? Les certitudes de l’action unilatérale sont-elles remises en cause ?
02 rénovant l’action sociale et médico-sociale), les politiques de droit commun, le «mainstreaming», le paradigme de l’usager sont à la mode. Le secteur social et médico-social est un des derniers à faire, en droit, à l’usager une nouvelle place et celle-ci obéit à deux principes : participation et transparence. Elle oblige les établissements à s’interroger sur leurs pratiques. Ceux-ci doivent faire émerger cette nouvelle «citoyenneté» dans les différentes acceptions du terme, tout en protégeant ces personnes souvent «vulnérables», aux yeux de la loi.
Dans le rapport étroit entre droit des usagers et citoyenneté, que deviennent les questions relatives à la négociation, au consentement éclairé, au contrat ? Les certitudes de l’action unilatérale sont-elles remises en cause ?