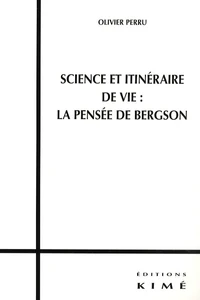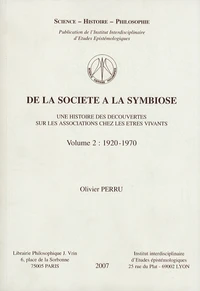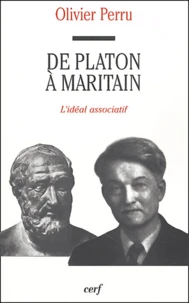Professeur d'histoire et de philosophie des sciences.
Science, raison et religion en France au XIXe siècle. Tome 1, Oeuvres philosophiques et littéraires traitant du rapport entre sciences, raison et religion au XIXe siècle
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 8 juillet et le 9 juilletCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 3 à 6 jours après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 8 juillet et le 9 juillet
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages250
- PrésentationBroché
- Poids0.54 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 1,6 cm
- ISBN978-2-910425-33-3
- EAN9782910425333
- Date de parution30/12/2014
- CollectionScience, Histoire, Philosophie
- ÉditeurIIEE
Résumé
La problématique du rapport entre science et religion au XIXe siècle s'organise autour de quelques personnages et de questions récurrentes. Marqués par la Révolution, les hommes du premier XIXe siècle sont dans le rejet des Lumières, donc, dans le rejet des sciences et de leur développement, leur préférant une forme d'intelligence soit littéraire et artistique (Chateaubriand), soit religieuse ou philosophique (Joseph de Maistre).
Le développement des sciences physiques est vu comme desséchant l'esprit, détournant l'homme du vrai sens de son existence. Le public cultivé du XIXe siècle sera marqué par cette position fragile et infondée ; l'opposition science - religion imprégnera les mentalités. Une sensibilité religieuse émotive ne fera que renforcer le rejet de la culture scientifique. Parmi les acteurs de la vie de l'Eglise et de la société du premier dix-neuvième siècle, Mgr Dominique Dufour de Pradt et l'abbé Louis Bautain tenteront de promouvoir un rapport plus équilibré entre science et foi.
Il faut aussi mentionner le rôle d'Ozanam concernant la place de l'intelligence et de la culture dans l'engagement chrétien. Mais jusqu'en 1830, les responsables politiques et religieux, tels Mgr Frayssinous, demeurent très méfiants vis-à-vis des sciences. Lamennais et Renan se sont attaqués, de manière différente mais non sans recoupement, à la question de la nature de la science, ce que souligne une étude précise des textes.
Après la rédaction de L'avenir de la science, on a l'impression que la rupture entre Eglise et science est inévitable et quasi consommée ; les années 1850 commenceraient sur fond de conflit général. Or, les choses ne sont pas si simples ; les deux derniers chapitres et le second volume montreront que les catholiques ont aussi activement participé à l'élaboration scientifique du XIXe siècle, surtout dans les sciences naturelles encore peu professionnalisées et très descriptives
Le développement des sciences physiques est vu comme desséchant l'esprit, détournant l'homme du vrai sens de son existence. Le public cultivé du XIXe siècle sera marqué par cette position fragile et infondée ; l'opposition science - religion imprégnera les mentalités. Une sensibilité religieuse émotive ne fera que renforcer le rejet de la culture scientifique. Parmi les acteurs de la vie de l'Eglise et de la société du premier dix-neuvième siècle, Mgr Dominique Dufour de Pradt et l'abbé Louis Bautain tenteront de promouvoir un rapport plus équilibré entre science et foi.
Il faut aussi mentionner le rôle d'Ozanam concernant la place de l'intelligence et de la culture dans l'engagement chrétien. Mais jusqu'en 1830, les responsables politiques et religieux, tels Mgr Frayssinous, demeurent très méfiants vis-à-vis des sciences. Lamennais et Renan se sont attaqués, de manière différente mais non sans recoupement, à la question de la nature de la science, ce que souligne une étude précise des textes.
Après la rédaction de L'avenir de la science, on a l'impression que la rupture entre Eglise et science est inévitable et quasi consommée ; les années 1850 commenceraient sur fond de conflit général. Or, les choses ne sont pas si simples ; les deux derniers chapitres et le second volume montreront que les catholiques ont aussi activement participé à l'élaboration scientifique du XIXe siècle, surtout dans les sciences naturelles encore peu professionnalisées et très descriptives
La problématique du rapport entre science et religion au XIXe siècle s'organise autour de quelques personnages et de questions récurrentes. Marqués par la Révolution, les hommes du premier XIXe siècle sont dans le rejet des Lumières, donc, dans le rejet des sciences et de leur développement, leur préférant une forme d'intelligence soit littéraire et artistique (Chateaubriand), soit religieuse ou philosophique (Joseph de Maistre).
Le développement des sciences physiques est vu comme desséchant l'esprit, détournant l'homme du vrai sens de son existence. Le public cultivé du XIXe siècle sera marqué par cette position fragile et infondée ; l'opposition science - religion imprégnera les mentalités. Une sensibilité religieuse émotive ne fera que renforcer le rejet de la culture scientifique. Parmi les acteurs de la vie de l'Eglise et de la société du premier dix-neuvième siècle, Mgr Dominique Dufour de Pradt et l'abbé Louis Bautain tenteront de promouvoir un rapport plus équilibré entre science et foi.
Il faut aussi mentionner le rôle d'Ozanam concernant la place de l'intelligence et de la culture dans l'engagement chrétien. Mais jusqu'en 1830, les responsables politiques et religieux, tels Mgr Frayssinous, demeurent très méfiants vis-à-vis des sciences. Lamennais et Renan se sont attaqués, de manière différente mais non sans recoupement, à la question de la nature de la science, ce que souligne une étude précise des textes.
Après la rédaction de L'avenir de la science, on a l'impression que la rupture entre Eglise et science est inévitable et quasi consommée ; les années 1850 commenceraient sur fond de conflit général. Or, les choses ne sont pas si simples ; les deux derniers chapitres et le second volume montreront que les catholiques ont aussi activement participé à l'élaboration scientifique du XIXe siècle, surtout dans les sciences naturelles encore peu professionnalisées et très descriptives
Le développement des sciences physiques est vu comme desséchant l'esprit, détournant l'homme du vrai sens de son existence. Le public cultivé du XIXe siècle sera marqué par cette position fragile et infondée ; l'opposition science - religion imprégnera les mentalités. Une sensibilité religieuse émotive ne fera que renforcer le rejet de la culture scientifique. Parmi les acteurs de la vie de l'Eglise et de la société du premier dix-neuvième siècle, Mgr Dominique Dufour de Pradt et l'abbé Louis Bautain tenteront de promouvoir un rapport plus équilibré entre science et foi.
Il faut aussi mentionner le rôle d'Ozanam concernant la place de l'intelligence et de la culture dans l'engagement chrétien. Mais jusqu'en 1830, les responsables politiques et religieux, tels Mgr Frayssinous, demeurent très méfiants vis-à-vis des sciences. Lamennais et Renan se sont attaqués, de manière différente mais non sans recoupement, à la question de la nature de la science, ce que souligne une étude précise des textes.
Après la rédaction de L'avenir de la science, on a l'impression que la rupture entre Eglise et science est inévitable et quasi consommée ; les années 1850 commenceraient sur fond de conflit général. Or, les choses ne sont pas si simples ; les deux derniers chapitres et le second volume montreront que les catholiques ont aussi activement participé à l'élaboration scientifique du XIXe siècle, surtout dans les sciences naturelles encore peu professionnalisées et très descriptives