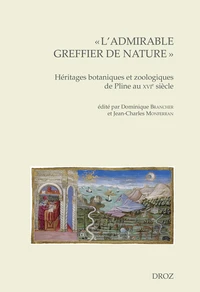Quand l'esprit vient aux plantes. Botanique sensible et subversion libertine (XVIe-XVIIe siècles)
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 19 juillet et le 2 aoûtCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera expédié 2 à 4 semaines après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 19 juillet et le 2 août
- Nombre de pages370
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.54 kg
- Dimensions15,0 cm × 22,0 cm × 3,0 cm
- ISBN978-2-600-01837-1
- EAN9782600018371
- Date de parution01/09/2015
- CollectionLes seuils de la modernité
- ÉditeurDroz
Résumé
"L'arbre gémit, soupire, pleure d'une voix humaine", et Michelet ajoute : "On croit que c'est le vent, mais c'est souvent les rêves de l'âme végétale". Aux XVIe et XVIIe siècles, botanistes, romanciers et philosophes ont eux aussi rêvé et pensé la plante, en lui conférant un statut moral et ontologique équivoque. Car, sous leur plume, brouillant les frontières entre flore, faune et humanité, parfois l'esprit et le désir viennent aux plantes.
Dès lors ce n'est plus seulement la mise en valeur de l'intelligence animale, mais aussi la promotion d'une pensée et d'une sensibilité végétales qui nourrissent la critique de l'anthropocentrisme dans l'Europe pré-moderne. Un tel trouble catégoriel, bien sûr, inquiète et stimule les efforts pour comprendre et distinguer les différentes sortes de vivants. Mais la revalorisation de l'âme inférieure des plantes se situe aussi du côté de la dissidence doctrinale, l'être végétal menaçant de destituer l'homme.
Aussi s'agissait-il de penser les usages subversifs du monde de Flore et les conflits entre le principe d'un étagement entre les règnes et une conception plus poreuse des frontières du vivant.
Dès lors ce n'est plus seulement la mise en valeur de l'intelligence animale, mais aussi la promotion d'une pensée et d'une sensibilité végétales qui nourrissent la critique de l'anthropocentrisme dans l'Europe pré-moderne. Un tel trouble catégoriel, bien sûr, inquiète et stimule les efforts pour comprendre et distinguer les différentes sortes de vivants. Mais la revalorisation de l'âme inférieure des plantes se situe aussi du côté de la dissidence doctrinale, l'être végétal menaçant de destituer l'homme.
Aussi s'agissait-il de penser les usages subversifs du monde de Flore et les conflits entre le principe d'un étagement entre les règnes et une conception plus poreuse des frontières du vivant.
"L'arbre gémit, soupire, pleure d'une voix humaine", et Michelet ajoute : "On croit que c'est le vent, mais c'est souvent les rêves de l'âme végétale". Aux XVIe et XVIIe siècles, botanistes, romanciers et philosophes ont eux aussi rêvé et pensé la plante, en lui conférant un statut moral et ontologique équivoque. Car, sous leur plume, brouillant les frontières entre flore, faune et humanité, parfois l'esprit et le désir viennent aux plantes.
Dès lors ce n'est plus seulement la mise en valeur de l'intelligence animale, mais aussi la promotion d'une pensée et d'une sensibilité végétales qui nourrissent la critique de l'anthropocentrisme dans l'Europe pré-moderne. Un tel trouble catégoriel, bien sûr, inquiète et stimule les efforts pour comprendre et distinguer les différentes sortes de vivants. Mais la revalorisation de l'âme inférieure des plantes se situe aussi du côté de la dissidence doctrinale, l'être végétal menaçant de destituer l'homme.
Aussi s'agissait-il de penser les usages subversifs du monde de Flore et les conflits entre le principe d'un étagement entre les règnes et une conception plus poreuse des frontières du vivant.
Dès lors ce n'est plus seulement la mise en valeur de l'intelligence animale, mais aussi la promotion d'une pensée et d'une sensibilité végétales qui nourrissent la critique de l'anthropocentrisme dans l'Europe pré-moderne. Un tel trouble catégoriel, bien sûr, inquiète et stimule les efforts pour comprendre et distinguer les différentes sortes de vivants. Mais la revalorisation de l'âme inférieure des plantes se situe aussi du côté de la dissidence doctrinale, l'être végétal menaçant de destituer l'homme.
Aussi s'agissait-il de penser les usages subversifs du monde de Flore et les conflits entre le principe d'un étagement entre les règnes et une conception plus poreuse des frontières du vivant.