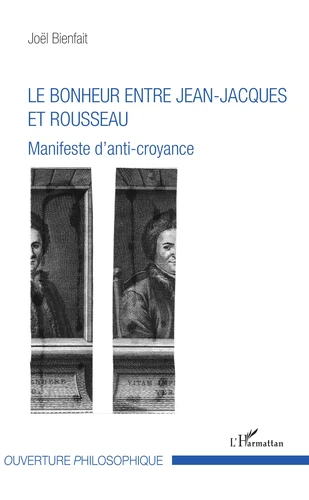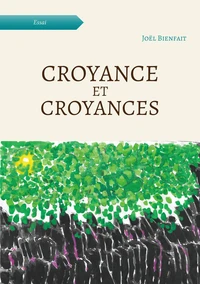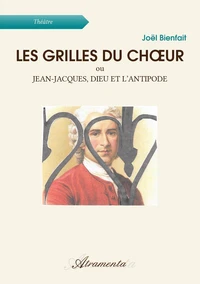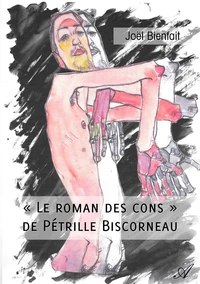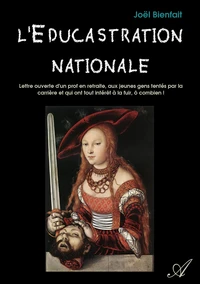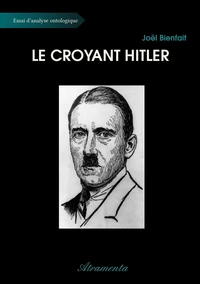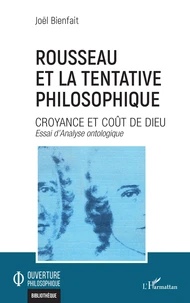Le bonheur entre Jean-Jacques et Rousseau. Manifeste d'anti-croyance
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 22 juillet et le 25 juilletCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 3 à 6 jours après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 22 juillet et le 25 juillet
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages148
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.309 kg
- Dimensions13,5 cm × 21,5 cm × 1,8 cm
- ISBN978-2-343-14512-9
- EAN9782343145129
- Date de parution27/06/2018
- CollectionOuverture philosophique
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
Le bonheur : idée neuve ou trop vieux rêve ? Douce utopie ou vrai projet ? En tout cas, quand un philosophe se lève avec Jean- Jacques Rousseau en 1749, c'est en son nom : le bonheur constitue son horizon et son programme, sa vocation et son présent, à la fois sa quête personnelle et le seul don qu'il estime devoir à l'homme. Or il se trouve que, face au philosophe Rousseau, se met bientôt à parler aussi le romancier Jean-Jacques, et du même coup face au penseur le croyant.
Quant au bonheur, les deux instances sont d'accord sur sa définition et sur tous les aspects qui en sont parties intégrantes, conscience, estime de soi, liberté, dignité, sagesse ; de même, elles sont d'accord pour identifier ses pires ennemis, ces fétiches que sont l'avoir, le pouvoir et la gloire, tout ce qui suscite les croyances constitutives du " religieux mondain ". Mais une fois les idoles écartées, il reste Dieu, ou le " religieux divin ".
Que devient alors le bonheur pris ainsi entre Jean-Jacques et Rousseau ? Peut-il être compatible avec cette ultime croyance ? C'est tout le rapport du bonheur et de la croyance, quelle qu'elle soit, qui est ici étudié à travers l'oeuvre du Citoyen de Genève.
Quant au bonheur, les deux instances sont d'accord sur sa définition et sur tous les aspects qui en sont parties intégrantes, conscience, estime de soi, liberté, dignité, sagesse ; de même, elles sont d'accord pour identifier ses pires ennemis, ces fétiches que sont l'avoir, le pouvoir et la gloire, tout ce qui suscite les croyances constitutives du " religieux mondain ". Mais une fois les idoles écartées, il reste Dieu, ou le " religieux divin ".
Que devient alors le bonheur pris ainsi entre Jean-Jacques et Rousseau ? Peut-il être compatible avec cette ultime croyance ? C'est tout le rapport du bonheur et de la croyance, quelle qu'elle soit, qui est ici étudié à travers l'oeuvre du Citoyen de Genève.
Le bonheur : idée neuve ou trop vieux rêve ? Douce utopie ou vrai projet ? En tout cas, quand un philosophe se lève avec Jean- Jacques Rousseau en 1749, c'est en son nom : le bonheur constitue son horizon et son programme, sa vocation et son présent, à la fois sa quête personnelle et le seul don qu'il estime devoir à l'homme. Or il se trouve que, face au philosophe Rousseau, se met bientôt à parler aussi le romancier Jean-Jacques, et du même coup face au penseur le croyant.
Quant au bonheur, les deux instances sont d'accord sur sa définition et sur tous les aspects qui en sont parties intégrantes, conscience, estime de soi, liberté, dignité, sagesse ; de même, elles sont d'accord pour identifier ses pires ennemis, ces fétiches que sont l'avoir, le pouvoir et la gloire, tout ce qui suscite les croyances constitutives du " religieux mondain ". Mais une fois les idoles écartées, il reste Dieu, ou le " religieux divin ".
Que devient alors le bonheur pris ainsi entre Jean-Jacques et Rousseau ? Peut-il être compatible avec cette ultime croyance ? C'est tout le rapport du bonheur et de la croyance, quelle qu'elle soit, qui est ici étudié à travers l'oeuvre du Citoyen de Genève.
Quant au bonheur, les deux instances sont d'accord sur sa définition et sur tous les aspects qui en sont parties intégrantes, conscience, estime de soi, liberté, dignité, sagesse ; de même, elles sont d'accord pour identifier ses pires ennemis, ces fétiches que sont l'avoir, le pouvoir et la gloire, tout ce qui suscite les croyances constitutives du " religieux mondain ". Mais une fois les idoles écartées, il reste Dieu, ou le " religieux divin ".
Que devient alors le bonheur pris ainsi entre Jean-Jacques et Rousseau ? Peut-il être compatible avec cette ultime croyance ? C'est tout le rapport du bonheur et de la croyance, quelle qu'elle soit, qui est ici étudié à travers l'oeuvre du Citoyen de Genève.