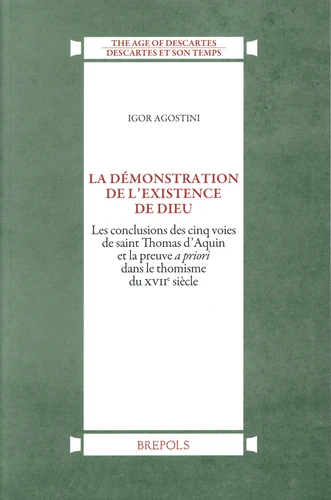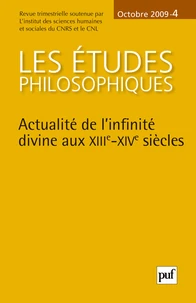La démonstration de l'existence de Dieu. Les conclusions des cinq voies de saint Thomas d’Aquin et la preuve a priori dans le thomisme du XVIIe siècle
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 2 août et le 19 aoûtCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera expédié 2 à 4 semaines après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 2 août et le 19 août
- Nombre de pages704
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids1.18 kg
- Dimensions15,6 cm × 23,5 cm × 4,4 cm
- ISBN978-2-503-56578-1
- EAN9782503565781
- Date de parution01/01/2016
- CollectionDescartes et son temps
- ÉditeurBrepols
Résumé
Dans l'histoire du thomisme, le XVIIe siècle constitue, aujourd'hui encore, une période peu étudiée et mal connue, du moins si on la compare aux siècles précédents. Tenter de combler cette lacune à partir d'un thème capital, le débat portant sur la quaestio II de la Prima pars de la Summa theologiae dans le thomisme du XVIIe siècle, tel est l'objet de ce livre. L'enquête s'y déroule en deux parties : la première porte sur le problème de la valeur des conclusions des cinq voies à partir de la problématique soulevée par Cajétan ; la seconde, sur la discussion de la possibilité d'une démonstration a priori de l'existence de Dieu.
Ces deux controverses sont parmi les plus intenses concernant le débat multiforme sur l'existence de Dieu dans la scolastique du XVIIe siècle, mais aussi de la théologie dominicaine de l'époque, qui joue, dans l'une comme dans l'autre, un rôle de premier plan ; de façon prévisible, peut-être, dans le premier cas, dans un débat qui tient son origine d'un auteur dominicain, et de façon imprévisible dans le second, en raison de la pénétration, parmi les disciples de saint Thomas eux-mêmes, de la preuve a priori au sein de l'article 2 de la quaestio II de la première partie de la Summa theologiae, texte canonique pour la thèse de la démontrabilité a posteriori de l'existence de Dieu.
En reconstruisant l'histoire, aujourd'hui presque entièrement oubliée, de ces deux controverses, l'ambition de ce livre est d'offrir une contribution qui soit une exégèse des textes de saint Thomas faisant débat, dans la conviction que la connaissance de la tradition thomiste constitue un support essentiel à l'encadrement et à la résolution des questions interprétatives posées par le texte des articles 2 et 3 de la quaestio II.
L'histoire devient ici, pour une part du moins, un instrument qui assiste l'interprétation.
Ces deux controverses sont parmi les plus intenses concernant le débat multiforme sur l'existence de Dieu dans la scolastique du XVIIe siècle, mais aussi de la théologie dominicaine de l'époque, qui joue, dans l'une comme dans l'autre, un rôle de premier plan ; de façon prévisible, peut-être, dans le premier cas, dans un débat qui tient son origine d'un auteur dominicain, et de façon imprévisible dans le second, en raison de la pénétration, parmi les disciples de saint Thomas eux-mêmes, de la preuve a priori au sein de l'article 2 de la quaestio II de la première partie de la Summa theologiae, texte canonique pour la thèse de la démontrabilité a posteriori de l'existence de Dieu.
En reconstruisant l'histoire, aujourd'hui presque entièrement oubliée, de ces deux controverses, l'ambition de ce livre est d'offrir une contribution qui soit une exégèse des textes de saint Thomas faisant débat, dans la conviction que la connaissance de la tradition thomiste constitue un support essentiel à l'encadrement et à la résolution des questions interprétatives posées par le texte des articles 2 et 3 de la quaestio II.
L'histoire devient ici, pour une part du moins, un instrument qui assiste l'interprétation.
Dans l'histoire du thomisme, le XVIIe siècle constitue, aujourd'hui encore, une période peu étudiée et mal connue, du moins si on la compare aux siècles précédents. Tenter de combler cette lacune à partir d'un thème capital, le débat portant sur la quaestio II de la Prima pars de la Summa theologiae dans le thomisme du XVIIe siècle, tel est l'objet de ce livre. L'enquête s'y déroule en deux parties : la première porte sur le problème de la valeur des conclusions des cinq voies à partir de la problématique soulevée par Cajétan ; la seconde, sur la discussion de la possibilité d'une démonstration a priori de l'existence de Dieu.
Ces deux controverses sont parmi les plus intenses concernant le débat multiforme sur l'existence de Dieu dans la scolastique du XVIIe siècle, mais aussi de la théologie dominicaine de l'époque, qui joue, dans l'une comme dans l'autre, un rôle de premier plan ; de façon prévisible, peut-être, dans le premier cas, dans un débat qui tient son origine d'un auteur dominicain, et de façon imprévisible dans le second, en raison de la pénétration, parmi les disciples de saint Thomas eux-mêmes, de la preuve a priori au sein de l'article 2 de la quaestio II de la première partie de la Summa theologiae, texte canonique pour la thèse de la démontrabilité a posteriori de l'existence de Dieu.
En reconstruisant l'histoire, aujourd'hui presque entièrement oubliée, de ces deux controverses, l'ambition de ce livre est d'offrir une contribution qui soit une exégèse des textes de saint Thomas faisant débat, dans la conviction que la connaissance de la tradition thomiste constitue un support essentiel à l'encadrement et à la résolution des questions interprétatives posées par le texte des articles 2 et 3 de la quaestio II.
L'histoire devient ici, pour une part du moins, un instrument qui assiste l'interprétation.
Ces deux controverses sont parmi les plus intenses concernant le débat multiforme sur l'existence de Dieu dans la scolastique du XVIIe siècle, mais aussi de la théologie dominicaine de l'époque, qui joue, dans l'une comme dans l'autre, un rôle de premier plan ; de façon prévisible, peut-être, dans le premier cas, dans un débat qui tient son origine d'un auteur dominicain, et de façon imprévisible dans le second, en raison de la pénétration, parmi les disciples de saint Thomas eux-mêmes, de la preuve a priori au sein de l'article 2 de la quaestio II de la première partie de la Summa theologiae, texte canonique pour la thèse de la démontrabilité a posteriori de l'existence de Dieu.
En reconstruisant l'histoire, aujourd'hui presque entièrement oubliée, de ces deux controverses, l'ambition de ce livre est d'offrir une contribution qui soit une exégèse des textes de saint Thomas faisant débat, dans la conviction que la connaissance de la tradition thomiste constitue un support essentiel à l'encadrement et à la résolution des questions interprétatives posées par le texte des articles 2 et 3 de la quaestio II.
L'histoire devient ici, pour une part du moins, un instrument qui assiste l'interprétation.