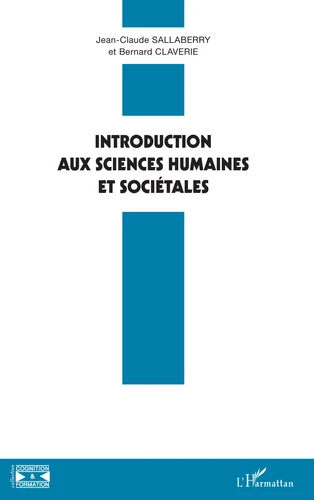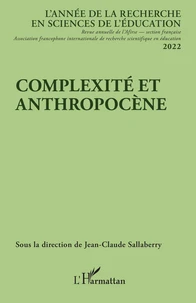Introduction aux sciences humaines et sociétales
Par : ,Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 5 août et le 6 aoûtCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 3 à 6 jours après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 5 août et le 6 août
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages208
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.335 kg
- Dimensions15,5 cm × 24,0 cm × 1,0 cm
- ISBN978-2-343-14357-6
- EAN9782343143576
- Date de parution01/03/2018
- CollectionCognition et Formation
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
L'idée directrice de cet ouvrage est celle d'une évidence pourtant encore discutée aujourd'hui. Les sciences humaines et sociétales ne peuvent plus ne pas s'inspirer de l'évolution de la science au XXe et au début de ce XXIe siècle. Loin de se vouloir exhaustifs, quatre grands "événements" sont choisis en tant qu'exemples marquants de cette exigence : - le mouvement structuraliste, qui amène à la théorie des systèmes, - l'apparition de la physique quantique, qui a radicalement bouleversé bien des conceptions admises dans l'explication du monde physique, - la naissance et le développement des sciences cognitives et des neurosciences, qui balayent un substrat de la pensée et de la cognition conçu comme "boite noire" , - la complexité, qui ouvre les perspectives de l'auto l'organisation et de l'émergence.
Au fil de l'ouvrage, face aux "exigences" pour la modélisation qui découlent de ce souci de prise en compte, l'outillage fourni par les ensembles théoriques convoqués (théorie de l'institution, théorie des systèmes, cognitique, théorie de la représentation associée à une théorie du champ) et retravaillés par les auteurs, permet d'y répondre, ainsi que de donner quelques outils pour la modélisation des "phénomènes" humains et sociétaux.
Au fil de l'ouvrage, face aux "exigences" pour la modélisation qui découlent de ce souci de prise en compte, l'outillage fourni par les ensembles théoriques convoqués (théorie de l'institution, théorie des systèmes, cognitique, théorie de la représentation associée à une théorie du champ) et retravaillés par les auteurs, permet d'y répondre, ainsi que de donner quelques outils pour la modélisation des "phénomènes" humains et sociétaux.
L'idée directrice de cet ouvrage est celle d'une évidence pourtant encore discutée aujourd'hui. Les sciences humaines et sociétales ne peuvent plus ne pas s'inspirer de l'évolution de la science au XXe et au début de ce XXIe siècle. Loin de se vouloir exhaustifs, quatre grands "événements" sont choisis en tant qu'exemples marquants de cette exigence : - le mouvement structuraliste, qui amène à la théorie des systèmes, - l'apparition de la physique quantique, qui a radicalement bouleversé bien des conceptions admises dans l'explication du monde physique, - la naissance et le développement des sciences cognitives et des neurosciences, qui balayent un substrat de la pensée et de la cognition conçu comme "boite noire" , - la complexité, qui ouvre les perspectives de l'auto l'organisation et de l'émergence.
Au fil de l'ouvrage, face aux "exigences" pour la modélisation qui découlent de ce souci de prise en compte, l'outillage fourni par les ensembles théoriques convoqués (théorie de l'institution, théorie des systèmes, cognitique, théorie de la représentation associée à une théorie du champ) et retravaillés par les auteurs, permet d'y répondre, ainsi que de donner quelques outils pour la modélisation des "phénomènes" humains et sociétaux.
Au fil de l'ouvrage, face aux "exigences" pour la modélisation qui découlent de ce souci de prise en compte, l'outillage fourni par les ensembles théoriques convoqués (théorie de l'institution, théorie des systèmes, cognitique, théorie de la représentation associée à une théorie du champ) et retravaillés par les auteurs, permet d'y répondre, ainsi que de donner quelques outils pour la modélisation des "phénomènes" humains et sociétaux.