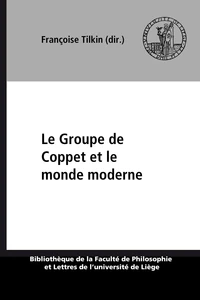" Champs linguistiques " crée un nouvel espace de réflexion sur tous les aspects du langage en éclairant la recherche contemporaine en linguistique française, sans a priori théorique et en ne négligeant aucune discipline. Pour les linguistes professionnels : une occasion de donner libre champ à leurs recherches.
Pour les amoureux de la langue : une manière d'élargir le champ de leurs connaissances.
Pour les étudiants : un outil de travail et de réflexion.
Qui, du théoricien au praticien, ne se sent pas, à un moment donné, concerné par les différentes marques typographiques ? Ces " chaînes " et ces " poulies " du texte, comme les appelle l'écrivain François Bon, n'obligent-elles pas tout lecteur, quelles que soient ses motivations, à s'interroger sur les rapports entre l'oralité et l'écriture, l'écriture et la lecture, la norme et l'usage, le dit et le non-dit, le discours cité et le discours citant, le dire et le faire ?
Les questions posées sont multiples : quels rapports la ponctuation entretient-elle avec la parole orale ? Dans quelles mesures les signes de ponctuation sont-ils censés représenter des signes paralinguistiques ? Comment la ponctuation encourage-t-elle le lecteur à mettre son expérience à profit pour participer à l'élaboration du message textuel ? Pourquoi et comment établir, enseigner, traduire la ponctuation ?
L'intérêt grandissant pour la ponctuation oblige à une comparaison interdisciplinaire des diverses approches du phénomène. En posant la question À qui appartient la ponctuation ?, cet ouvrage a voulu réunir des spécialistes d'horizons divers pour leur donner l'occasion de confronter leur expérience sur le sujet : linguistes, pragmaticiens, rhétoriciens, critiques, philologues, sémioticiens, mais aussi informaticiens, historiens des langues, traducteurs et enseignants.
" Champs linguistiques " crée un nouvel espace de réflexion sur tous les aspects du langage en éclairant la recherche contemporaine en linguistique française, sans a priori théorique et en ne négligeant aucune discipline. Pour les linguistes professionnels : une occasion de donner libre champ à leurs recherches.
Pour les amoureux de la langue : une manière d'élargir le champ de leurs connaissances.
Pour les étudiants : un outil de travail et de réflexion.
Qui, du théoricien au praticien, ne se sent pas, à un moment donné, concerné par les différentes marques typographiques ? Ces " chaînes " et ces " poulies " du texte, comme les appelle l'écrivain François Bon, n'obligent-elles pas tout lecteur, quelles que soient ses motivations, à s'interroger sur les rapports entre l'oralité et l'écriture, l'écriture et la lecture, la norme et l'usage, le dit et le non-dit, le discours cité et le discours citant, le dire et le faire ?
Les questions posées sont multiples : quels rapports la ponctuation entretient-elle avec la parole orale ? Dans quelles mesures les signes de ponctuation sont-ils censés représenter des signes paralinguistiques ? Comment la ponctuation encourage-t-elle le lecteur à mettre son expérience à profit pour participer à l'élaboration du message textuel ? Pourquoi et comment établir, enseigner, traduire la ponctuation ?
L'intérêt grandissant pour la ponctuation oblige à une comparaison interdisciplinaire des diverses approches du phénomène. En posant la question À qui appartient la ponctuation ?, cet ouvrage a voulu réunir des spécialistes d'horizons divers pour leur donner l'occasion de confronter leur expérience sur le sujet : linguistes, pragmaticiens, rhétoriciens, critiques, philologues, sémioticiens, mais aussi informaticiens, historiens des langues, traducteurs et enseignants.