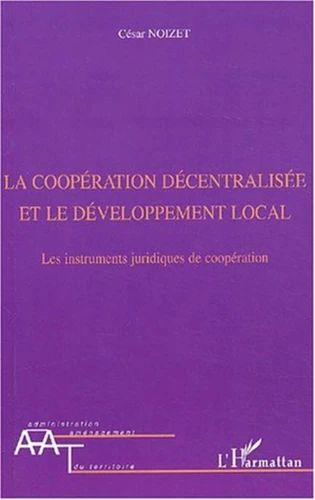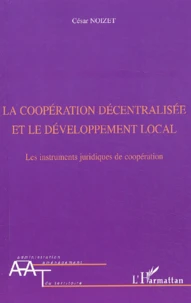La coopération décentralisée et le développement local.. Les instruments juridiques de coopération
Par :Formats :
Disponible dans votre compte client Decitre ou Furet du Nord dès validation de votre commande. Le format PDF est :
- Compatible avec une lecture sur My Vivlio (smartphone, tablette, ordinateur)
- Compatible avec une lecture sur liseuses Vivlio
- Pour les liseuses autres que Vivlio, vous devez utiliser le logiciel Adobe Digital Edition. Non compatible avec la lecture sur les liseuses Kindle, Remarkable et Sony
 , qui est-ce ?
, qui est-ce ?Notre partenaire de plateforme de lecture numérique où vous retrouverez l'ensemble de vos ebooks gratuitement
Pour en savoir plus sur nos ebooks, consultez notre aide en ligne ici
- Nombre de pages348
- FormatPDF
- ISBN2-296-32013-9
- EAN9782296320130
- Date de parution01/04/2003
- Copier Coller01 page(s) autorisée(s)
- Protection num.Digital Watermarking
- Taille13 Mo
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
La coopération décentralisée est une coopération particulière entre les collectivités territoriales françaises et leurs homologues étrangers qui permet de réaliser des actions de développement local. Si les actions de coopération transfrontalière sont inéluctables et nombreuses, les actions dans le cadre de la coopération pour le développement et de la coopération au niveau communautaire se développent selon les besoins locaux et la volonté politique.
Principalement orienté vers la coopération transfrontalière, le droit français autorise cependant toutes les actions de coopération. L'article 65 de la loi du 2 mars 1982 a permis aux collectivités locales de mettre en œuvre des actions transfrontalières dans le cadre de leurs compétences afin de réaliser des actions de développement. Toutefois les restrictions et les imprécisions de cet article ont amené les différents acteurs à rechercher une légitimité de ces actions dans l'article 72 de la Constitution et dans la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités locales.
Face à la multiplication des actions, la législation autorise désormais, dans certaines limites, les collectivités territoriales française à mener des actions avec leurs homologues étrangers dans le cadre d'un organisme de coopération. Soutenus par le Conseil de l'Europe pour les actions transfrontalières et interrégionales communautaires, les Etats ont conclu des conventions internationales et mettent en place des commissions inter-étatiques sur certaines frontières.
Mais pour concrétiser les actions de coopération décentralisée, les collectivités territoriales doivent recourir à des organismes de coopération dotés ou non de la personnalité juridique qui concourent à la connaissance mutuelle, au rapprochement et à la réalisation de projets d'intérêt commun. Cependant la multiplication de ces organismes ne permet pas toujours de résoudre toutes les difficultés et provoque une impression anarchique et redondante voire même d'inutilité pour certaines structures.
Si une création rationnelle et pragmatique des organismes de coopération s'impose aux collectivités territoriales, les Etats doivent parallèlement s'engager à harmoniser leurs droits internes, les structures ne pouvant à elles seules résoudre les difficultés récurrentes rencontrées dans le cadre des actions de coopération.
Principalement orienté vers la coopération transfrontalière, le droit français autorise cependant toutes les actions de coopération. L'article 65 de la loi du 2 mars 1982 a permis aux collectivités locales de mettre en œuvre des actions transfrontalières dans le cadre de leurs compétences afin de réaliser des actions de développement. Toutefois les restrictions et les imprécisions de cet article ont amené les différents acteurs à rechercher une légitimité de ces actions dans l'article 72 de la Constitution et dans la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités locales.
Face à la multiplication des actions, la législation autorise désormais, dans certaines limites, les collectivités territoriales française à mener des actions avec leurs homologues étrangers dans le cadre d'un organisme de coopération. Soutenus par le Conseil de l'Europe pour les actions transfrontalières et interrégionales communautaires, les Etats ont conclu des conventions internationales et mettent en place des commissions inter-étatiques sur certaines frontières.
Mais pour concrétiser les actions de coopération décentralisée, les collectivités territoriales doivent recourir à des organismes de coopération dotés ou non de la personnalité juridique qui concourent à la connaissance mutuelle, au rapprochement et à la réalisation de projets d'intérêt commun. Cependant la multiplication de ces organismes ne permet pas toujours de résoudre toutes les difficultés et provoque une impression anarchique et redondante voire même d'inutilité pour certaines structures.
Si une création rationnelle et pragmatique des organismes de coopération s'impose aux collectivités territoriales, les Etats doivent parallèlement s'engager à harmoniser leurs droits internes, les structures ne pouvant à elles seules résoudre les difficultés récurrentes rencontrées dans le cadre des actions de coopération.
La coopération décentralisée est une coopération particulière entre les collectivités territoriales françaises et leurs homologues étrangers qui permet de réaliser des actions de développement local. Si les actions de coopération transfrontalière sont inéluctables et nombreuses, les actions dans le cadre de la coopération pour le développement et de la coopération au niveau communautaire se développent selon les besoins locaux et la volonté politique.
Principalement orienté vers la coopération transfrontalière, le droit français autorise cependant toutes les actions de coopération. L'article 65 de la loi du 2 mars 1982 a permis aux collectivités locales de mettre en œuvre des actions transfrontalières dans le cadre de leurs compétences afin de réaliser des actions de développement. Toutefois les restrictions et les imprécisions de cet article ont amené les différents acteurs à rechercher une légitimité de ces actions dans l'article 72 de la Constitution et dans la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités locales.
Face à la multiplication des actions, la législation autorise désormais, dans certaines limites, les collectivités territoriales française à mener des actions avec leurs homologues étrangers dans le cadre d'un organisme de coopération. Soutenus par le Conseil de l'Europe pour les actions transfrontalières et interrégionales communautaires, les Etats ont conclu des conventions internationales et mettent en place des commissions inter-étatiques sur certaines frontières.
Mais pour concrétiser les actions de coopération décentralisée, les collectivités territoriales doivent recourir à des organismes de coopération dotés ou non de la personnalité juridique qui concourent à la connaissance mutuelle, au rapprochement et à la réalisation de projets d'intérêt commun. Cependant la multiplication de ces organismes ne permet pas toujours de résoudre toutes les difficultés et provoque une impression anarchique et redondante voire même d'inutilité pour certaines structures.
Si une création rationnelle et pragmatique des organismes de coopération s'impose aux collectivités territoriales, les Etats doivent parallèlement s'engager à harmoniser leurs droits internes, les structures ne pouvant à elles seules résoudre les difficultés récurrentes rencontrées dans le cadre des actions de coopération.
Principalement orienté vers la coopération transfrontalière, le droit français autorise cependant toutes les actions de coopération. L'article 65 de la loi du 2 mars 1982 a permis aux collectivités locales de mettre en œuvre des actions transfrontalières dans le cadre de leurs compétences afin de réaliser des actions de développement. Toutefois les restrictions et les imprécisions de cet article ont amené les différents acteurs à rechercher une légitimité de ces actions dans l'article 72 de la Constitution et dans la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités locales.
Face à la multiplication des actions, la législation autorise désormais, dans certaines limites, les collectivités territoriales française à mener des actions avec leurs homologues étrangers dans le cadre d'un organisme de coopération. Soutenus par le Conseil de l'Europe pour les actions transfrontalières et interrégionales communautaires, les Etats ont conclu des conventions internationales et mettent en place des commissions inter-étatiques sur certaines frontières.
Mais pour concrétiser les actions de coopération décentralisée, les collectivités territoriales doivent recourir à des organismes de coopération dotés ou non de la personnalité juridique qui concourent à la connaissance mutuelle, au rapprochement et à la réalisation de projets d'intérêt commun. Cependant la multiplication de ces organismes ne permet pas toujours de résoudre toutes les difficultés et provoque une impression anarchique et redondante voire même d'inutilité pour certaines structures.
Si une création rationnelle et pragmatique des organismes de coopération s'impose aux collectivités territoriales, les Etats doivent parallèlement s'engager à harmoniser leurs droits internes, les structures ne pouvant à elles seules résoudre les difficultés récurrentes rencontrées dans le cadre des actions de coopération.