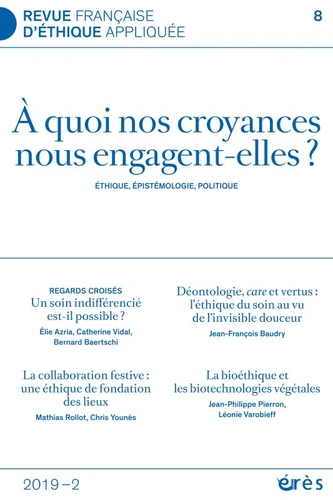Revue française d'éthique appliquée N° 8/2019-2
A quoi nos croyances nous engagent-elles ?. Ethique, épistémologie, politique
Par : , , , Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 10 décembreCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 5 jours après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 10 décembre
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages168
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.396 kg
- Dimensions16,0 cm × 23,8 cm × 1,3 cm
- ISBN978-2-7492-6464-6
- EAN9782749264646
- Date de parution16/01/2020
- ÉditeurErès
Résumé
Avons - nous le droit de croire ce que nous voulons croire ? En 1877, William Clifford forge l'expression " éthique des croyances " et formule la thèse selon laquelle il est toujours moralement mauvais, en tout lieu et pour chacun, de croire quoi que ce soit sur des bases insuffisantes . Dans un contexte social de crise de légitimité des autorités, de défiance grandissante vis - à - vis du discours scientifique (notamment médical) et plus généralement de la figure des experts, au moment où l'innovation numérique et technologique rend possible la manipulation massive et dynamique des croyances, la question de la croyance, de son statut, de la confiance que l'on peut lui accorder, de sa justification, se repose à nouveaux frais.
Que peut dire l'éthique de nos croyances, de leurs sources, des autorités qui les font naître, les modifient ou les entretiennent ? Comment peut - elle aborder la croyance, fréquemment considérée comme relevant de l'intime ou dépendant d'un processus déontologique de justification, mais dans les deux cas n'engageant pas de responsabilité autre qu'à soi - même ?
Que peut dire l'éthique de nos croyances, de leurs sources, des autorités qui les font naître, les modifient ou les entretiennent ? Comment peut - elle aborder la croyance, fréquemment considérée comme relevant de l'intime ou dépendant d'un processus déontologique de justification, mais dans les deux cas n'engageant pas de responsabilité autre qu'à soi - même ?
Avons - nous le droit de croire ce que nous voulons croire ? En 1877, William Clifford forge l'expression " éthique des croyances " et formule la thèse selon laquelle il est toujours moralement mauvais, en tout lieu et pour chacun, de croire quoi que ce soit sur des bases insuffisantes . Dans un contexte social de crise de légitimité des autorités, de défiance grandissante vis - à - vis du discours scientifique (notamment médical) et plus généralement de la figure des experts, au moment où l'innovation numérique et technologique rend possible la manipulation massive et dynamique des croyances, la question de la croyance, de son statut, de la confiance que l'on peut lui accorder, de sa justification, se repose à nouveaux frais.
Que peut dire l'éthique de nos croyances, de leurs sources, des autorités qui les font naître, les modifient ou les entretiennent ? Comment peut - elle aborder la croyance, fréquemment considérée comme relevant de l'intime ou dépendant d'un processus déontologique de justification, mais dans les deux cas n'engageant pas de responsabilité autre qu'à soi - même ?
Que peut dire l'éthique de nos croyances, de leurs sources, des autorités qui les font naître, les modifient ou les entretiennent ? Comment peut - elle aborder la croyance, fréquemment considérée comme relevant de l'intime ou dépendant d'un processus déontologique de justification, mais dans les deux cas n'engageant pas de responsabilité autre qu'à soi - même ?