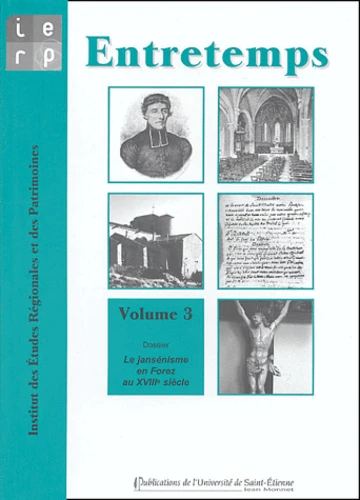Entretemps N° 3
Le jansénisme en Forez au XVIIIe siècle
Par : , , , , Formats :
Actuellement indisponible
Cet article est actuellement indisponible, il ne peut pas être commandé sur notre site pour le moment. Nous vous invitons à vous inscrire à l'alerte disponibilité, vous recevrez un e-mail dès que cet ouvrage sera à nouveau disponible.
- Nombre de pages191
- PrésentationBroché
- Poids0.295 kg
- Dimensions14,9 cm × 20,8 cm × 1,1 cm
- ISBN2-86272-304-5
- EAN9782862723044
- Date de parution11/03/2004
- ÉditeurPU Saint-Etienne
Résumé
Ce troisième numéro d'Entretemps est consacré en
très grande partie à un des sujets qui, au sein de la
recherche locale, suscite actuellement un ample
renouvellement historiographique : le jansénisme
forézien des Lumières. Il propose plusieurs approches d'un courant dont les prolongements aux XIXe et XXe siècles ont longtemps davantage intéressé que sa genèse et son développement à la fin de l'époque moderne. S'appuyant sur des communautés religieuses, au premier rang desquelles les oratoriens de Notre-Dame-de-Grâces, mais aussi sur un certain nombre de " bons curés ", dont François Jacquemont à Saint-Médard-en-Forez demeure le plus illustre, ce mouvement, au faible caractère urbain, se modifie considérablement dans ses lieux et ses pratiques au cours du XVIIIe siècle : en passant du couvent au presbytère, il perd de son attachement à la culture livresque pour privilégier, avec près de quarante ans de retard par rapport à Paris, prophéties, miracles et convulsions, gagnant par là une dimension populaire qui survivra à la Révolution.
Ce troisième numéro d'Entretemps est consacré en
très grande partie à un des sujets qui, au sein de la
recherche locale, suscite actuellement un ample
renouvellement historiographique : le jansénisme
forézien des Lumières. Il propose plusieurs approches d'un courant dont les prolongements aux XIXe et XXe siècles ont longtemps davantage intéressé que sa genèse et son développement à la fin de l'époque moderne. S'appuyant sur des communautés religieuses, au premier rang desquelles les oratoriens de Notre-Dame-de-Grâces, mais aussi sur un certain nombre de " bons curés ", dont François Jacquemont à Saint-Médard-en-Forez demeure le plus illustre, ce mouvement, au faible caractère urbain, se modifie considérablement dans ses lieux et ses pratiques au cours du XVIIIe siècle : en passant du couvent au presbytère, il perd de son attachement à la culture livresque pour privilégier, avec près de quarante ans de retard par rapport à Paris, prophéties, miracles et convulsions, gagnant par là une dimension populaire qui survivra à la Révolution.