Retour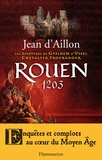
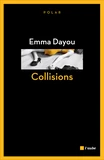
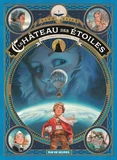
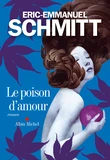
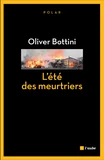
Les dernières notes et avis
Notes et avis 1 à 8 sur un total de 73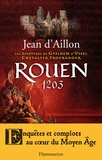
Rouen, 1203
Avis posté le 2014-10-27
De l'histoire et de l'Histoire
Jean d’Aillon livre la suite des aventures de son héros Guilhem d’Ussel. Elles sont un peu plus réussies que les précédentes, dont je n’ai lu que « Rome 1202 », qui s’établissent comme suit :
• De taille et d’estoc
• Marseille 1198
• Paris 1199
• Londres 1200
• Montségur 1201
• Rome 1202
Il faut déjà un bon quart ou un petit tiers, au choix, à Jean d’Aillon pour dresser le tableau général de son histoire, mettre en place les principaux protagonistes (hors la troupe de Guilhem d’Ussel) à savoir le clerc qui vire sa cuti et, grâce à de fortes prédispositions à l’emportement, devient brigand, l’ancien templier qui se trouve en possession d’une sainte relique sur laquelle lorgne notre clerc et Ali-i Sabbah, rafiq originaire d’Alamut, patrie des hassasseini ou hashischins selon les versions, en mission en France pour retrouver et punir le scientifique qui a volé de précieux documents dans la bibliothèque de la forteresse dont il vient.
Tout ce petit monde va croiser la route de Guilhem d’Ussel et se retrouver du côté de Rouen, au moment où le roi Philippe Auguste poursuit sa guerre contre Jean sans Terre en « bocages » normands.
Jean d’Aillon n’est pas avare de recherches historiques et le montre dans son livre avec moults précisions quant aux pédigrées des personnages réellement historiques, pléthores de références géographiques/historiques/politiques. Tout est archi-documenté. Un peu trop parfois et on a vite fait de se perdre tant les histoires d’alliances, de trahisons, de mésalliances, de haines, de jalousies ou de jeux de pouvoir sont complexes et tant les personnages de hauts rang sont tous plus ou moins liés familialement entre eux, plus ou moins cousins/oncles/tantes/nièces/frères/neveux les uns des autres.
C’est finalement par ce prisme là qu’il convient de lire ces livres, dans ce qu’ils ont de compte rendu d’une époque lointaine et mouvementée, dans ce qu’ils ont de témoignage de la vie de toutes les couches de la société, du plus humble au plus royal.
L’intrigue devient secondaire et n’est plus qu’un prétexte. Il devient alors délicat de la juger pour autre chose que cela : un artifice narratif pour habiller le véritable matériau du livre. Ma méconnaissance totale de cette époque ne me permet d’ailleurs pas de juger de la pertinence du trait de Jean d’Aillon. Toujours est-il que le roman est par trop ancré dans la réalité historique pour distiller à la trame narrative un souffle totalement échevelé et épique digne de Dumas, sans qu’il soit pour autant totalement absent.
Si on arrive à mettre de côté l’aspect didactique du livre, propre à ces récits historiques (et plus l’histoire est ancienne plus la didactique semble nécessaire), le caractère de Guilhem d’Ussel, aventurier au passé trouble, n’est pas sans attirer le lecteur dans ses filets et l’on se prend quand même à chevaucher avec lui, à tirer l’épée avec lui, à s’émouvoir avec lui, à se jeter dans la gueule du loup avec lui. Surtout dans les 80-90 dernières pages qui voient le dénouement approcher et l’histoire nettement s’accélérer pour un final plutôt « sportif ».
Le lien vers le blog : http://wp.me/p2X8E2-h7
Jean d’Aillon livre la suite des aventures de son héros Guilhem d’Ussel. Elles sont un peu plus réussies que les précédentes, dont je n’ai lu que « Rome 1202 », qui s’établissent comme suit :
• De taille et d’estoc
• Marseille 1198
• Paris 1199
• Londres 1200
• Montségur 1201
• Rome 1202
Il faut déjà un bon quart ou un petit tiers, au choix, à Jean d’Aillon pour dresser le tableau général de son histoire, mettre en place les principaux protagonistes (hors la troupe de Guilhem d’Ussel) à savoir le clerc qui vire sa cuti et, grâce à de fortes prédispositions à l’emportement, devient brigand, l’ancien templier qui se trouve en possession d’une sainte relique sur laquelle lorgne notre clerc et Ali-i Sabbah, rafiq originaire d’Alamut, patrie des hassasseini ou hashischins selon les versions, en mission en France pour retrouver et punir le scientifique qui a volé de précieux documents dans la bibliothèque de la forteresse dont il vient.
Tout ce petit monde va croiser la route de Guilhem d’Ussel et se retrouver du côté de Rouen, au moment où le roi Philippe Auguste poursuit sa guerre contre Jean sans Terre en « bocages » normands.
Jean d’Aillon n’est pas avare de recherches historiques et le montre dans son livre avec moults précisions quant aux pédigrées des personnages réellement historiques, pléthores de références géographiques/historiques/politiques. Tout est archi-documenté. Un peu trop parfois et on a vite fait de se perdre tant les histoires d’alliances, de trahisons, de mésalliances, de haines, de jalousies ou de jeux de pouvoir sont complexes et tant les personnages de hauts rang sont tous plus ou moins liés familialement entre eux, plus ou moins cousins/oncles/tantes/nièces/frères/neveux les uns des autres.
C’est finalement par ce prisme là qu’il convient de lire ces livres, dans ce qu’ils ont de compte rendu d’une époque lointaine et mouvementée, dans ce qu’ils ont de témoignage de la vie de toutes les couches de la société, du plus humble au plus royal.
L’intrigue devient secondaire et n’est plus qu’un prétexte. Il devient alors délicat de la juger pour autre chose que cela : un artifice narratif pour habiller le véritable matériau du livre. Ma méconnaissance totale de cette époque ne me permet d’ailleurs pas de juger de la pertinence du trait de Jean d’Aillon. Toujours est-il que le roman est par trop ancré dans la réalité historique pour distiller à la trame narrative un souffle totalement échevelé et épique digne de Dumas, sans qu’il soit pour autant totalement absent.
Si on arrive à mettre de côté l’aspect didactique du livre, propre à ces récits historiques (et plus l’histoire est ancienne plus la didactique semble nécessaire), le caractère de Guilhem d’Ussel, aventurier au passé trouble, n’est pas sans attirer le lecteur dans ses filets et l’on se prend quand même à chevaucher avec lui, à tirer l’épée avec lui, à s’émouvoir avec lui, à se jeter dans la gueule du loup avec lui. Surtout dans les 80-90 dernières pages qui voient le dénouement approcher et l’histoire nettement s’accélérer pour un final plutôt « sportif ».
Le lien vers le blog : http://wp.me/p2X8E2-h7
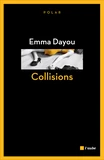
Collisions
Avis posté le 2014-10-23
Pour ne pas inverser les rôles de la victime et du coupable
« Pour certaines personnes, étrangement, le crime est la faute de la victime. Depuis ses débuts dans la police, Claire avait souvent rencontré cette perversion de la pensée. Elle était courante quand la victime était une femme, et quasiment toujours présente quand la violence subie était d’ordre sexuel. La victime avait modifié un détail dans l’organisation de sa journée, n’avait pas réglé une facture, aimait les hommes ou était une mauvaise mère. Elle s’était habillée en rouge ce jour-là, n’avait pas dit bonjour à son voisin, s’était arrêtée au mauvais endroit ou avait souri à la mauvaise personne. Dans les enquêtes de ce type, les témoins cherchaient curieusement une explication à l’agression, non pas dans le comportement de l’agresseur mais dans celui de l’agressée. »
Emma Dayou n’y va pas par quatre chemins : dès la première page, une femme, dans la quarantaine, est retrouvée nue, violée et assassinée, crucifiée sur un abribus. Claire, toute jeune lieutenant de la police judiciaire, fait partie de l’équipe chargée de l’enquête.
En parallèle de l’enquête sur ce meurtre sauvage bientôt suivi d’un second répondant au même modus operandi, on découvre Rose, adolescente qui a failli être victime d’une tournante orchestrée par ses « camarades » de classe et, y ayant échappé, harcelée dans l’enceinte du lycée par ces mêmes adolescents en mal de figure parentale ou de modèle d’éducation.
Que ce soit pour l’enquête policière ou pour l’histoire de Rose qui se débat avec ses démons intérieurs, le propos d’Emma Dayou est principalement de dénoncer la récurrence de la culpabilisation des victimes d’agressions à caractère sexuel.
Léa, la première victime, est décrite par son collègue de travail, accessoirement le père de Rose, comme une personne attirant les ennuis parce qu’inscrite sur un site de rencontre. Rose est accusée par ses agresseurs de les avoir aguichés, de les avoir provoqués. Elles se retrouvent dans la position consistant à les rendre responsables de leur propre malheur.
Si Léa n’a eu aucune chance d’échapper à son funeste sort, Rose pour sa part va essayer de retourner le rôle qu’on (ses agresseurs mais aussi la société civile, à travers d’une part son silence face à ce qui lui est arrivé et d’autre part son incapacité à gérer les problèmes de comportement de ses agresseurs, et dans une moindre mesure son père qui sans aller jusqu’à la culpabiliser ne souhaite qu’enterrer l’affaire) tente de lui attribuer et, pour son propre salut, de dénoncer ce qui s’est passé.
Ce qui frappe avant tout, c’est l’empathie que met Emma Dayou dans ses personnages féminins (Rose qui tente de s’en sortir avec l’aide d’Estelle, la conseillère d’éducation, bienveillante, Sophie Jussieu, la meilleure amie de la première victime…) et la haine qu’elle distille dans les personnages masculins (Patrick, le dragueur, fainéant qui s’est sort financièrement en séduisant ses « proies », en les consommant et en les rejetant aussi vite que possible, Paul, le père de Rose, qui ne perdra ses œillères qu’à la fin du récit, Benoît, la petite frappe du lycée et celui qui a attiré Rose dans le piège qui devait lui être fatal). Il y a bien quelques exceptions masculines comme l’un des collègues de Claire qui ne supporte les violences faites aux femmes, Alex, un copain de classe de Rose qui s’en amourache et veut la venger…
Les relations homme/femme sont compliquées chez Emma qui les stigmatise en créant des relations prédateur/proies ou coupable/victime, y compris dans les relations parents/enfants…
Certes, Emma habille les meurtres de Léa et de la seconde victime de façon atroce et macabre, mais en dehors de ces scories sanglantes, violentes et dégradantes, la plume d’Emma est emprunte d’un mélange de hargne et de tendresse qui fonctionne assez bien et rétablit les faits dans ce qu’ils ont de plus abruptes : une victime n’est jamais coupable de l’agression qu’elle a subie. Et puis, si face à la violence, les réponses évoquées par Emma sont « fuir, subir ou combattre », comme le fait Japp (voir chronique de Barbarie 2.0), au moins elle ne pousse-t-elle pas le vice jusqu’à dépasser la simple notion de défense pour sombrer dans le renversement réel des rôles et, à travers l’acharnement physique de la première sur le second, transformer la victime en coupable et le coupable en victime. Estelle se réjouit ainsi d’avoir pu se défendre sans tuer son agresseur malgré la violence de sa réaction, salutaire au demeurant puisqu’elle lui aura sauvé la vie.
Même si le traitement de cette relation victime/coupable aurait pu être plus poussé et les histoires de Léa et Rose faire l’objet de deux livres distincts, je recommande…
Lien vers le blog : http://wp.me/p2X8E2-gN
« Pour certaines personnes, étrangement, le crime est la faute de la victime. Depuis ses débuts dans la police, Claire avait souvent rencontré cette perversion de la pensée. Elle était courante quand la victime était une femme, et quasiment toujours présente quand la violence subie était d’ordre sexuel. La victime avait modifié un détail dans l’organisation de sa journée, n’avait pas réglé une facture, aimait les hommes ou était une mauvaise mère. Elle s’était habillée en rouge ce jour-là, n’avait pas dit bonjour à son voisin, s’était arrêtée au mauvais endroit ou avait souri à la mauvaise personne. Dans les enquêtes de ce type, les témoins cherchaient curieusement une explication à l’agression, non pas dans le comportement de l’agresseur mais dans celui de l’agressée. »
Emma Dayou n’y va pas par quatre chemins : dès la première page, une femme, dans la quarantaine, est retrouvée nue, violée et assassinée, crucifiée sur un abribus. Claire, toute jeune lieutenant de la police judiciaire, fait partie de l’équipe chargée de l’enquête.
En parallèle de l’enquête sur ce meurtre sauvage bientôt suivi d’un second répondant au même modus operandi, on découvre Rose, adolescente qui a failli être victime d’une tournante orchestrée par ses « camarades » de classe et, y ayant échappé, harcelée dans l’enceinte du lycée par ces mêmes adolescents en mal de figure parentale ou de modèle d’éducation.
Que ce soit pour l’enquête policière ou pour l’histoire de Rose qui se débat avec ses démons intérieurs, le propos d’Emma Dayou est principalement de dénoncer la récurrence de la culpabilisation des victimes d’agressions à caractère sexuel.
Léa, la première victime, est décrite par son collègue de travail, accessoirement le père de Rose, comme une personne attirant les ennuis parce qu’inscrite sur un site de rencontre. Rose est accusée par ses agresseurs de les avoir aguichés, de les avoir provoqués. Elles se retrouvent dans la position consistant à les rendre responsables de leur propre malheur.
Si Léa n’a eu aucune chance d’échapper à son funeste sort, Rose pour sa part va essayer de retourner le rôle qu’on (ses agresseurs mais aussi la société civile, à travers d’une part son silence face à ce qui lui est arrivé et d’autre part son incapacité à gérer les problèmes de comportement de ses agresseurs, et dans une moindre mesure son père qui sans aller jusqu’à la culpabiliser ne souhaite qu’enterrer l’affaire) tente de lui attribuer et, pour son propre salut, de dénoncer ce qui s’est passé.
Ce qui frappe avant tout, c’est l’empathie que met Emma Dayou dans ses personnages féminins (Rose qui tente de s’en sortir avec l’aide d’Estelle, la conseillère d’éducation, bienveillante, Sophie Jussieu, la meilleure amie de la première victime…) et la haine qu’elle distille dans les personnages masculins (Patrick, le dragueur, fainéant qui s’est sort financièrement en séduisant ses « proies », en les consommant et en les rejetant aussi vite que possible, Paul, le père de Rose, qui ne perdra ses œillères qu’à la fin du récit, Benoît, la petite frappe du lycée et celui qui a attiré Rose dans le piège qui devait lui être fatal). Il y a bien quelques exceptions masculines comme l’un des collègues de Claire qui ne supporte les violences faites aux femmes, Alex, un copain de classe de Rose qui s’en amourache et veut la venger…
Les relations homme/femme sont compliquées chez Emma qui les stigmatise en créant des relations prédateur/proies ou coupable/victime, y compris dans les relations parents/enfants…
Certes, Emma habille les meurtres de Léa et de la seconde victime de façon atroce et macabre, mais en dehors de ces scories sanglantes, violentes et dégradantes, la plume d’Emma est emprunte d’un mélange de hargne et de tendresse qui fonctionne assez bien et rétablit les faits dans ce qu’ils ont de plus abruptes : une victime n’est jamais coupable de l’agression qu’elle a subie. Et puis, si face à la violence, les réponses évoquées par Emma sont « fuir, subir ou combattre », comme le fait Japp (voir chronique de Barbarie 2.0), au moins elle ne pousse-t-elle pas le vice jusqu’à dépasser la simple notion de défense pour sombrer dans le renversement réel des rôles et, à travers l’acharnement physique de la première sur le second, transformer la victime en coupable et le coupable en victime. Estelle se réjouit ainsi d’avoir pu se défendre sans tuer son agresseur malgré la violence de sa réaction, salutaire au demeurant puisqu’elle lui aura sauvé la vie.
Même si le traitement de cette relation victime/coupable aurait pu être plus poussé et les histoires de Léa et Rose faire l’objet de deux livres distincts, je recommande…
Lien vers le blog : http://wp.me/p2X8E2-gN
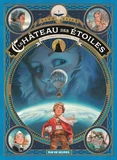
Le château des étoiles Tome 1
1869 : la conquête de l'espace. Première partie
1869 : la conquête de l'espace. Première partie
Avis posté le 2014-10-14
Quel beau rêve que celui d'Alex Alice
Alex Alice n’est pas un nom inconnu dans le domaine de la bande dessinée. De par « Le troisième testament » dont il a scénarisé les 7 tomes et dessiné les 4 premiers, il s’est fait connaître du grand public à travers un récit ésotérico-religieux qui avait pris ses lettres de noblesses dans les années 90 avant, de par la pléthore de titres, de passer, un peu comme le thriller en littérature, au rang de facilités éditoriales souvent bâclées. Passons ce débat pour aborder ce « Château des étoiles » bien loin de ces considérations scénaristiques.
Alex Alice nous entraîne ici sur les traces de Jules Verne avec une technique de couleurs directes inédite pour lui. Le résultat est plutôt enthousiasmant.
Pour ce qui est de l’histoire, nous suivons, fin XIX° siècle, Séraphin dont la mère s’est tuée en ballon stratosphérique à la poursuite de l’éther, censé pouvoir faire voyager dans l’espace. Séraphin et son père reçoivent un jour une lettre les informant que le journal de bord de Claire a été retrouvé en Allemagne et les invitant à travailler sur la suite du projet de la mère de Séraphin.
Le grand ordonnateur et argentier du projet de voyage dans l’espace n’est autre que le roi Louis II de Bavière, prisonnier de ses propres rêves et de la bataille qui l’oppose à Bismark. Si le premier voit dans la maîtrise de l’éther et la construction d’un vaisseau capable de voyager dans l’espace un moyen de plus pour s’évader et continuer à sombrer dans une excentricité fatale, le second y voit l’occasion d’avoir une arme de guerre inégalable et à nulle autre pareille.
Ce tome 1 regroupe les 3 premiers volets de l’histoire publiés sous forme de journal. 3 autres volets sont à paraître et un deuxième tome les regroupant aussi. Il s’achève sur la construction de l’éthernef par le père de Séraphin qui aura entre temps tenté de déjouer un complot contre le roi. Ce roi si particulier est présenté ici avec une dose certaine d’affection, plus rêveur qu’excentrique d’ailleurs.
Les premières planches, je l’avoue m’ont laissé sceptique, et puis la magie de Jules Verne prend et Alex Alice nous emmène où il veut, on le suit, on le croit, on gobe tout ce qu’il nous raconte, tout ce qu’il invente.
La couleur directe donne une touche de douceur, de tendresse à l’histoire d’Alex Alice soulignée aussi par le personnage de Sophie, la jeune servante qui aide Séraphin, et de son demi-frère Hans qui, lui, semble échappé d’un dessin animé de Miyazaki.
C’est une douce rêverie qu’il est heureux de savourer douillettement avant de s’endormir des étoiles plein la tête.
Bonus : un entretien avec Alex Alice sur BDGEST.
Lien vers mon blog : http://wp.me/p2X8E2-gD
Alex Alice n’est pas un nom inconnu dans le domaine de la bande dessinée. De par « Le troisième testament » dont il a scénarisé les 7 tomes et dessiné les 4 premiers, il s’est fait connaître du grand public à travers un récit ésotérico-religieux qui avait pris ses lettres de noblesses dans les années 90 avant, de par la pléthore de titres, de passer, un peu comme le thriller en littérature, au rang de facilités éditoriales souvent bâclées. Passons ce débat pour aborder ce « Château des étoiles » bien loin de ces considérations scénaristiques.
Alex Alice nous entraîne ici sur les traces de Jules Verne avec une technique de couleurs directes inédite pour lui. Le résultat est plutôt enthousiasmant.
Pour ce qui est de l’histoire, nous suivons, fin XIX° siècle, Séraphin dont la mère s’est tuée en ballon stratosphérique à la poursuite de l’éther, censé pouvoir faire voyager dans l’espace. Séraphin et son père reçoivent un jour une lettre les informant que le journal de bord de Claire a été retrouvé en Allemagne et les invitant à travailler sur la suite du projet de la mère de Séraphin.
Le grand ordonnateur et argentier du projet de voyage dans l’espace n’est autre que le roi Louis II de Bavière, prisonnier de ses propres rêves et de la bataille qui l’oppose à Bismark. Si le premier voit dans la maîtrise de l’éther et la construction d’un vaisseau capable de voyager dans l’espace un moyen de plus pour s’évader et continuer à sombrer dans une excentricité fatale, le second y voit l’occasion d’avoir une arme de guerre inégalable et à nulle autre pareille.
Ce tome 1 regroupe les 3 premiers volets de l’histoire publiés sous forme de journal. 3 autres volets sont à paraître et un deuxième tome les regroupant aussi. Il s’achève sur la construction de l’éthernef par le père de Séraphin qui aura entre temps tenté de déjouer un complot contre le roi. Ce roi si particulier est présenté ici avec une dose certaine d’affection, plus rêveur qu’excentrique d’ailleurs.
Les premières planches, je l’avoue m’ont laissé sceptique, et puis la magie de Jules Verne prend et Alex Alice nous emmène où il veut, on le suit, on le croit, on gobe tout ce qu’il nous raconte, tout ce qu’il invente.
La couleur directe donne une touche de douceur, de tendresse à l’histoire d’Alex Alice soulignée aussi par le personnage de Sophie, la jeune servante qui aide Séraphin, et de son demi-frère Hans qui, lui, semble échappé d’un dessin animé de Miyazaki.
C’est une douce rêverie qu’il est heureux de savourer douillettement avant de s’endormir des étoiles plein la tête.
Bonus : un entretien avec Alex Alice sur BDGEST.
Lien vers mon blog : http://wp.me/p2X8E2-gD
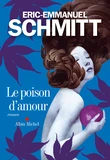
Le poison d'amour
Avis posté le 2014-10-13
L'amour est enfant de Bohème...
Ce « poison d’amour » tracasse quatre jeunes adolescentes, à l’orée de leur devenir de femmes, alors qu’elles sont en premières, montent avec leur professeur « Roméo et Juliette » de Shakespeare et découvrent les émois provoqués par l’amour et son pendant physique : le sexe.
C’est un roman sur le mal-être, sur le désespoir en l’avenir, en l’amour et en l’amitié, une ode à la trahison, au dépit amoureux. On se croirait pour un peu dans un film de Christophe Honoré façon « je t’aime moi non plus » aux amours prise de tête, les chansons en moins…
Colombe, Julia, Anouchka et Raphaëlle sont les meilleures amies du monde, de leur petit monde un peu mièvre, un peu cul-cul la praline qui tourne autour des mecs mais surtout autour d’elle : le regard qu’elles portent aux autres mais surtout à elles-mêmes avec tout la gangue de manque d’assurance, d’estime de soi que cela implique quand elles se comparent aux autres.
Colombe est la « nana canon » du groupe, celle qui a la plus belle poitrine et celle qui attire le plus les garçons et celle qui en consommera le plus. Julia est la plus sceptique face à l’amour et sa récente déception amoureuse provoquera, sur le mode « dominos », une suite de situations aux conséquences dramatiques.
Anouchka est la plus « neutre » du groupe. Celle qui passa inaperçue, celle dont les parents ne sont pas séparés, celle qui parait normale et donc transparente parce qu’elle n’a rien de particulier, ni dans sa vie, ni physiquement.
Raphaëlle est le garçon manquée de la troue, la fouineuse, la curieuse qui sera l’étincelle qui mettre le feu aux poudres. C’est d’ailleurs elle qui jouera Roméo dans la pièce et donnera la réplique à Julia qui aura fait des pieds et des mains pour tenir le rôle de Juliette.
Sur les 170 pages de ce livre, la première moitié est à l’image de ces adolescentes qui n’ont pas fini de mûrir : un peu superficielles. Sont-elles réellement nécessaires à la mise en place du drame qui se joue en coulisse ? Un peu mais elles ne sont pas totalement convaincantes. La seconde moitié du livre est plus réussie et l’auteur parvient enfin à intéresser le lecteur aux jeux pervers qui se jouent entre les quatre amies.
Un livre plaisant, un brin intrigant sur la fin, mais pas franchement indispensable dont je ne suis pas sûr qu’il reflète vraiment les adolescents d’aujourd’hui ou alors ceux d’un certain milieu privilégié. Mais après tout, je ne côtoie pas d’adolescents, du moins pas encore…
Lien vers le blog : http://wp.me/p2X8E2-gB
Ce « poison d’amour » tracasse quatre jeunes adolescentes, à l’orée de leur devenir de femmes, alors qu’elles sont en premières, montent avec leur professeur « Roméo et Juliette » de Shakespeare et découvrent les émois provoqués par l’amour et son pendant physique : le sexe.
C’est un roman sur le mal-être, sur le désespoir en l’avenir, en l’amour et en l’amitié, une ode à la trahison, au dépit amoureux. On se croirait pour un peu dans un film de Christophe Honoré façon « je t’aime moi non plus » aux amours prise de tête, les chansons en moins…
Colombe, Julia, Anouchka et Raphaëlle sont les meilleures amies du monde, de leur petit monde un peu mièvre, un peu cul-cul la praline qui tourne autour des mecs mais surtout autour d’elle : le regard qu’elles portent aux autres mais surtout à elles-mêmes avec tout la gangue de manque d’assurance, d’estime de soi que cela implique quand elles se comparent aux autres.
Colombe est la « nana canon » du groupe, celle qui a la plus belle poitrine et celle qui attire le plus les garçons et celle qui en consommera le plus. Julia est la plus sceptique face à l’amour et sa récente déception amoureuse provoquera, sur le mode « dominos », une suite de situations aux conséquences dramatiques.
Anouchka est la plus « neutre » du groupe. Celle qui passa inaperçue, celle dont les parents ne sont pas séparés, celle qui parait normale et donc transparente parce qu’elle n’a rien de particulier, ni dans sa vie, ni physiquement.
Raphaëlle est le garçon manquée de la troue, la fouineuse, la curieuse qui sera l’étincelle qui mettre le feu aux poudres. C’est d’ailleurs elle qui jouera Roméo dans la pièce et donnera la réplique à Julia qui aura fait des pieds et des mains pour tenir le rôle de Juliette.
Sur les 170 pages de ce livre, la première moitié est à l’image de ces adolescentes qui n’ont pas fini de mûrir : un peu superficielles. Sont-elles réellement nécessaires à la mise en place du drame qui se joue en coulisse ? Un peu mais elles ne sont pas totalement convaincantes. La seconde moitié du livre est plus réussie et l’auteur parvient enfin à intéresser le lecteur aux jeux pervers qui se jouent entre les quatre amies.
Un livre plaisant, un brin intrigant sur la fin, mais pas franchement indispensable dont je ne suis pas sûr qu’il reflète vraiment les adolescents d’aujourd’hui ou alors ceux d’un certain milieu privilégié. Mais après tout, je ne côtoie pas d’adolescents, du moins pas encore…
Lien vers le blog : http://wp.me/p2X8E2-gB
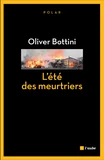
L'été des meurtriers
Avis posté le 2014-10-06
Bottini tout feu tout flamme
On retrouve Louise Boni après sa cure de désintoxication et après quelques mois passés dans le monastère qui accueillait en son sein et à son insu le trafic d’enfants, objet du précédent « Meurtre sous le signe du zen ».
Louise a repris du service et se retrouve associée à une enquête sur l’incendie d’une grange à Kirchzarten, toujours aux alentours de Fribourg, sous laquelle, sous l’effet de la chaleur, explose une véritable armurerie cachée dans une cave secrète. La présence d’un nombre effarant d’armes mais l’absence totale de munition inquiète tous les niveaux judiciaro-politico-policiers allemands qui part bille en tête sur la poste des néo-nazis alors que tout semble pointer en direction de la piste serbo-croate.
On retrouve le style de Bottini qui n’a pas changé la recette de son précédent livre : le lecteur est se perd avec plaisir dans un style à la fois très précis sur la forme (en terme de vocabulaire, très bien écrit) et à la fois très elliptique sur le fond (beaucoup de choses passent par les non-dits, les phrases en rupture on les discussion qui ne sont jamais véritablement achevées entre les protagonistes, tout comme les réflexions de chaque personnage qui ne sont jamais livrées dans leur intégralité, tout cela pour mieux rebondir quelques pages plus loin).
Bottini, après le trafic d’enfants pour pédophiles dans le premier livre, s’attaque au trafic d’armes et aux imbrications de l’Allemagne vis-à-vis du douloureux conflit d’ex-Yougoslavie et vis-à-vis du Pakistan et de cette région véritable poudrière.
Bottini tire un fil rouge tout au long du livre où il est question de responsabilité et donc de culpabilité. Et elles sont nombreuses… Responsabilité/culpabilité de Louise face à l’alcool (que ce soit par rapport à son ancien état d’alcoolique ou par rapport aux tentations face auxquelles elle lutte à tout bout de champs), de Louise face aux personnes qu’elle a tuées ou blessées directement ou indirectement (Calambert le pédophile, Niksch et Hollerer dans le premier tome, son frère qui s’est tué, le propriétaire de la grange qui abritait la cache des armes), de Louise par rapport à Richard Landen qu’elle convoite et dont le couple se fissure, de Louise par rapport à ses collègues, de l’Allemagne par rapport aux crises identitaires qui ont pu jalonner son histoire récente des 30 dernières années ou au trafic d’armes auquel elle a largement participé.
« L’été des meurtriers » va donc plus loin me semble-t-il que « Meurtre sous le signe du zen » qui abordait pourtant déjà cette thématique mais de façon peut-être moins radicale, moins défaitiste.
Tout comme la neige était un symbole fort et rémanent du précédent livre, le feu tient ici son rôle cathartique même s’il n’apparaît que dans les premières pages mais comme élément déclencheur de la suite.
Un livre de Bottini est toujours un peu plus profond que la première accroche, que l’histoire policière. Bottini traite de la société dans laquelle il place ses personnages plus que d’une enquête policière, il s’attache plus aux personnages qu’aux crimes qui s’ils sont largement condamnés n’en demeurent au final qu’un cadre où les personnages et leurs interactions, entre eux et avec le monde dans lequel ils évoluent, prennent leur véritable dimension.
Il n’est pas totalement inutile de lire le premier livre pour apprécier le second à sa juste valeur.
Lien vers le blog : http://t.co/Dye5uUCqUd
On retrouve Louise Boni après sa cure de désintoxication et après quelques mois passés dans le monastère qui accueillait en son sein et à son insu le trafic d’enfants, objet du précédent « Meurtre sous le signe du zen ».
Louise a repris du service et se retrouve associée à une enquête sur l’incendie d’une grange à Kirchzarten, toujours aux alentours de Fribourg, sous laquelle, sous l’effet de la chaleur, explose une véritable armurerie cachée dans une cave secrète. La présence d’un nombre effarant d’armes mais l’absence totale de munition inquiète tous les niveaux judiciaro-politico-policiers allemands qui part bille en tête sur la poste des néo-nazis alors que tout semble pointer en direction de la piste serbo-croate.
On retrouve le style de Bottini qui n’a pas changé la recette de son précédent livre : le lecteur est se perd avec plaisir dans un style à la fois très précis sur la forme (en terme de vocabulaire, très bien écrit) et à la fois très elliptique sur le fond (beaucoup de choses passent par les non-dits, les phrases en rupture on les discussion qui ne sont jamais véritablement achevées entre les protagonistes, tout comme les réflexions de chaque personnage qui ne sont jamais livrées dans leur intégralité, tout cela pour mieux rebondir quelques pages plus loin).
Bottini, après le trafic d’enfants pour pédophiles dans le premier livre, s’attaque au trafic d’armes et aux imbrications de l’Allemagne vis-à-vis du douloureux conflit d’ex-Yougoslavie et vis-à-vis du Pakistan et de cette région véritable poudrière.
Bottini tire un fil rouge tout au long du livre où il est question de responsabilité et donc de culpabilité. Et elles sont nombreuses… Responsabilité/culpabilité de Louise face à l’alcool (que ce soit par rapport à son ancien état d’alcoolique ou par rapport aux tentations face auxquelles elle lutte à tout bout de champs), de Louise face aux personnes qu’elle a tuées ou blessées directement ou indirectement (Calambert le pédophile, Niksch et Hollerer dans le premier tome, son frère qui s’est tué, le propriétaire de la grange qui abritait la cache des armes), de Louise par rapport à Richard Landen qu’elle convoite et dont le couple se fissure, de Louise par rapport à ses collègues, de l’Allemagne par rapport aux crises identitaires qui ont pu jalonner son histoire récente des 30 dernières années ou au trafic d’armes auquel elle a largement participé.
« L’été des meurtriers » va donc plus loin me semble-t-il que « Meurtre sous le signe du zen » qui abordait pourtant déjà cette thématique mais de façon peut-être moins radicale, moins défaitiste.
Tout comme la neige était un symbole fort et rémanent du précédent livre, le feu tient ici son rôle cathartique même s’il n’apparaît que dans les premières pages mais comme élément déclencheur de la suite.
Un livre de Bottini est toujours un peu plus profond que la première accroche, que l’histoire policière. Bottini traite de la société dans laquelle il place ses personnages plus que d’une enquête policière, il s’attache plus aux personnages qu’aux crimes qui s’ils sont largement condamnés n’en demeurent au final qu’un cadre où les personnages et leurs interactions, entre eux et avec le monde dans lequel ils évoluent, prennent leur véritable dimension.
Il n’est pas totalement inutile de lire le premier livre pour apprécier le second à sa juste valeur.
Lien vers le blog : http://t.co/Dye5uUCqUd
