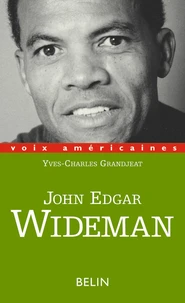Comment écrire le sexe en Amérique ? La guerre, la mélancolie, le désir... L'amateur de littérature américaine sait bien quelle relation tourmentée celle-ci entretient avec la chair et ses émois : l'héritage puritain d'une nation qui, aujourd'hui encore, se déchire à propos de morale sexuelle, n'est pas étranger à ce qui semble relever d'une immense névrose.
La libération sexuelle a fait son chemin et il est plus facile d'écrire le sexe. Mais il est toujours aussi difficile d'écrire le plaisir. Chez les écrivains issus des minorités ethniques, hommes (Elia Kazan, Petro Di Donato) ou femmes (Alma Villanueva, Gayl Jones), la sexualité est un champ de bataille où s'affrontent hommes et femmes, blancs et noirs, hétéro et homosexuels... Les relations sexuelles paraissent inévitablement fondées sur la violence et verrouillées par l'idéologie. Triste tableau, qu'on peut mettre en relation avec le sinistre
bilan de santé du corps social que dressent des écrivains comme James Elroy, le " pape du roman noir " ou, dans une moindre mesure, Raymond Carver.
Le désir n'est pas exclu du texte, mais s'il y apparaît, c'est sur le mode de la figuration négative. Et souvent hors d'Amérique. C'est le cas chez Malmud, Hawkes ou Cheever, où, comme chez Burroughs, le sexe se montre au revers du pêché, à l'ombre de la faute, ou encore dans les défaillances du texte, comme s'il ne pouvait s'exhiber que dans le mouvement même de son retrait.
Et si c'était le retrait, justement, qui était érotique ? Tant Hawkes et Nabokov que William Gass, Stanley Elkin, ou Hal Bennett et Clarence Major illustrent au bout du compte, et jusque dans les infimes mouvements de la syntaxe, en quoi les vacances et silences du texte sont les espaces où s'alimentent le mieux le désir de lecture, et le désir du lecteur.
Comment écrire le sexe en Amérique ? La guerre, la mélancolie, le désir... L'amateur de littérature américaine sait bien quelle relation tourmentée celle-ci entretient avec la chair et ses émois : l'héritage puritain d'une nation qui, aujourd'hui encore, se déchire à propos de morale sexuelle, n'est pas étranger à ce qui semble relever d'une immense névrose.
La libération sexuelle a fait son chemin et il est plus facile d'écrire le sexe. Mais il est toujours aussi difficile d'écrire le plaisir. Chez les écrivains issus des minorités ethniques, hommes (Elia Kazan, Petro Di Donato) ou femmes (Alma Villanueva, Gayl Jones), la sexualité est un champ de bataille où s'affrontent hommes et femmes, blancs et noirs, hétéro et homosexuels... Les relations sexuelles paraissent inévitablement fondées sur la violence et verrouillées par l'idéologie. Triste tableau, qu'on peut mettre en relation avec le sinistre
bilan de santé du corps social que dressent des écrivains comme James Elroy, le " pape du roman noir " ou, dans une moindre mesure, Raymond Carver.
Le désir n'est pas exclu du texte, mais s'il y apparaît, c'est sur le mode de la figuration négative. Et souvent hors d'Amérique. C'est le cas chez Malmud, Hawkes ou Cheever, où, comme chez Burroughs, le sexe se montre au revers du pêché, à l'ombre de la faute, ou encore dans les défaillances du texte, comme s'il ne pouvait s'exhiber que dans le mouvement même de son retrait.
Et si c'était le retrait, justement, qui était érotique ? Tant Hawkes et Nabokov que William Gass, Stanley Elkin, ou Hal Bennett et Clarence Major illustrent au bout du compte, et jusque dans les infimes mouvements de la syntaxe, en quoi les vacances et silences du texte sont les espaces où s'alimentent le mieux le désir de lecture, et le désir du lecteur.