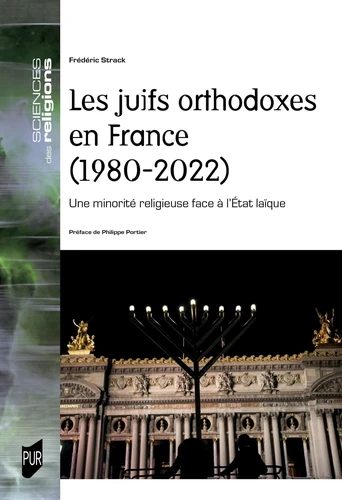Les juifs orthodoxes en France (1980 - 2023). Une minorité religieuse face à l'État laïque
Par :À paraître
Formats :
Précommande en ligneVotre colis est préparé et expédié le jour de la sortie de cet article, hors dimanches et jours fériés, dans la limite des stocks disponibles.
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 20 novembreVotre colis est préparé et expédié le jour de la sortie de cet article, hors dimanches et jours fériés, dans la limite des stocks disponibles.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay estimée à partir du 20 novembre
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- PrésentationBroché
- Poids0.001 kg
- ISBN979-10-413-0298-7
- EAN9791041302987
- Date de parution20/11/2025
- CollectionSciences des religions
- ÉditeurPU Rennes
Résumé
Quand on représente une institution publique laïque, comment réagir face à des pratiques religieuses de plus en plus diverses ? Quelles réponses apporter à des demandes à motifs religieux ? Quand on est un croyant rigoriste pour lequel la religion n'est pas une option, mais le coeur de la vie de tous les jours, comment pratiquer dans une société sécularisée ? Comment s'adresser à des responsables d'institutions publiques laïques ? Ces questions sont au coeur du débat public depuis une trentaine d'année, en France et en Europe.
Elles sont posées presque exclusivement au sujet des musulmans. Or, elles se posent aussi pour les juifs orthodoxes. Jusqu'alors passées sous silence, l'ouvrage les explore en plongeant au coeur de l'univers de sens des juifs orthodoxes pour comprendre comment il est travaillé par toutes sortes de positions, entre abandon, mise en retrait et investissement mesuré. Il montre aussi l'évolution de l'attitude des institutions publiques, inquiètes par un religieux trop visible.
Il nourrit donc un questionnement plus large sur l'inclusion des croyants rigoristes dans une société libérale et démocratique.
Elles sont posées presque exclusivement au sujet des musulmans. Or, elles se posent aussi pour les juifs orthodoxes. Jusqu'alors passées sous silence, l'ouvrage les explore en plongeant au coeur de l'univers de sens des juifs orthodoxes pour comprendre comment il est travaillé par toutes sortes de positions, entre abandon, mise en retrait et investissement mesuré. Il montre aussi l'évolution de l'attitude des institutions publiques, inquiètes par un religieux trop visible.
Il nourrit donc un questionnement plus large sur l'inclusion des croyants rigoristes dans une société libérale et démocratique.
Quand on représente une institution publique laïque, comment réagir face à des pratiques religieuses de plus en plus diverses ? Quelles réponses apporter à des demandes à motifs religieux ? Quand on est un croyant rigoriste pour lequel la religion n'est pas une option, mais le coeur de la vie de tous les jours, comment pratiquer dans une société sécularisée ? Comment s'adresser à des responsables d'institutions publiques laïques ? Ces questions sont au coeur du débat public depuis une trentaine d'année, en France et en Europe.
Elles sont posées presque exclusivement au sujet des musulmans. Or, elles se posent aussi pour les juifs orthodoxes. Jusqu'alors passées sous silence, l'ouvrage les explore en plongeant au coeur de l'univers de sens des juifs orthodoxes pour comprendre comment il est travaillé par toutes sortes de positions, entre abandon, mise en retrait et investissement mesuré. Il montre aussi l'évolution de l'attitude des institutions publiques, inquiètes par un religieux trop visible.
Il nourrit donc un questionnement plus large sur l'inclusion des croyants rigoristes dans une société libérale et démocratique.
Elles sont posées presque exclusivement au sujet des musulmans. Or, elles se posent aussi pour les juifs orthodoxes. Jusqu'alors passées sous silence, l'ouvrage les explore en plongeant au coeur de l'univers de sens des juifs orthodoxes pour comprendre comment il est travaillé par toutes sortes de positions, entre abandon, mise en retrait et investissement mesuré. Il montre aussi l'évolution de l'attitude des institutions publiques, inquiètes par un religieux trop visible.
Il nourrit donc un questionnement plus large sur l'inclusion des croyants rigoristes dans une société libérale et démocratique.