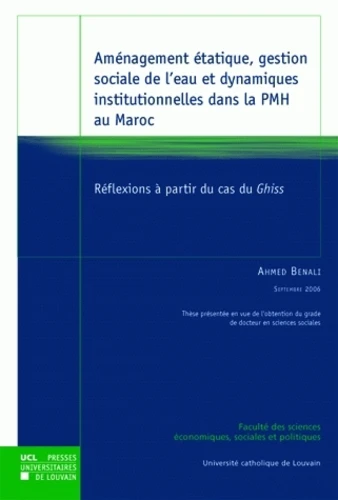Aménagement étatique, gestion sociale de l'eau et dynamiques institutionnelles dans la PMH au Maroc. Réflexions à partir du cas du Ghiss
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 28 août et le 6 septembreCet article doit être commandé chez un fournisseur. Votre colis vous sera expédié 8 à 17 jours après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 28 août et le 6 septembre
- Nombre de pages327
- PrésentationBroché
- Poids0.132 kg
- Dimensions16,0 cm × 24,0 cm × 1,7 cm
- ISBN2-87463-034-9
- EAN9782874630347
- Date de parution01/01/2006
- CollectionThèses de l'UCL
- ÉditeurPresses Universitaires Louvain
Résumé
Dans la mouvance des politiques d'ajustement structurel, la gestion de l'eau connaît des mutations profondes dues principalement à la redéfinition du rôle de l'Etat dans ce secteur. Au Maroc, l'une des principales conséquences de cette réforme est l'émergence des associations des usagers des eaux agricoles. Cette institution qui oeuvre dans un cadre renouvelé aux structures informelles déjà en place, rencontre beaucoup de difficultés pour mener sa mission.
Cette recherche de type empirique essaye d'appréhender une meilleure compréhension de la dynamique des institutions de gestion de l'eau. Elle est menée au travers d'analyses croisées où un ensemble de disciplines convergent pour appréhender la gestion de l'eau. Elle commence, par une approche historique, à retracer le processus du développement de l'irrigation au Maroc. Elle s'intéresse ensuite au Ghiss qui par, son histoire, sa diversité complexe de gestion des ressources hydriques...
, constitue un laboratoire intéressant pour l'étude de la gestion sociale de l'eau. Le rôle des acteurs a permis d'analyser l'évolution des institutions relatives à la gestion de l'eau. Le maintien des acteurs locaux, malgré la tentative de domination des acteurs nationaux et supranationaux a montré la capacité de résistance des premiers. Ces réponses locales mettent en lumière la capacité de ces acteurs à initier des changements qui répondent aux aspirations locales tout en préservant les acquis du passé.
En même temps, ils essayent de s'adapter aux possibilités offertes par les changements en cours. La place que doit réserver l'Etat à ces initiatives est questionnée. Nous prônons un Etat facilitateur et négociateur plutôt qu'entrepreneur et administrateur, c'est dans ce sens que nous avons évoqué le nouveau concept "d'indifférence positive e l'Etat" . L'information qualitative recueillie ainsi que le modèle théorique sont utilisés pour réaliser un exercice de prospective.
Celui-ci permet de montrer l'existence de plusieurs facteurs susceptibles d'entraîner un échec de cette transition institutionnelle. Quelques mesures permettant de limiter ce risque sont recommandées.
Cette recherche de type empirique essaye d'appréhender une meilleure compréhension de la dynamique des institutions de gestion de l'eau. Elle est menée au travers d'analyses croisées où un ensemble de disciplines convergent pour appréhender la gestion de l'eau. Elle commence, par une approche historique, à retracer le processus du développement de l'irrigation au Maroc. Elle s'intéresse ensuite au Ghiss qui par, son histoire, sa diversité complexe de gestion des ressources hydriques...
, constitue un laboratoire intéressant pour l'étude de la gestion sociale de l'eau. Le rôle des acteurs a permis d'analyser l'évolution des institutions relatives à la gestion de l'eau. Le maintien des acteurs locaux, malgré la tentative de domination des acteurs nationaux et supranationaux a montré la capacité de résistance des premiers. Ces réponses locales mettent en lumière la capacité de ces acteurs à initier des changements qui répondent aux aspirations locales tout en préservant les acquis du passé.
En même temps, ils essayent de s'adapter aux possibilités offertes par les changements en cours. La place que doit réserver l'Etat à ces initiatives est questionnée. Nous prônons un Etat facilitateur et négociateur plutôt qu'entrepreneur et administrateur, c'est dans ce sens que nous avons évoqué le nouveau concept "d'indifférence positive e l'Etat" . L'information qualitative recueillie ainsi que le modèle théorique sont utilisés pour réaliser un exercice de prospective.
Celui-ci permet de montrer l'existence de plusieurs facteurs susceptibles d'entraîner un échec de cette transition institutionnelle. Quelques mesures permettant de limiter ce risque sont recommandées.
Dans la mouvance des politiques d'ajustement structurel, la gestion de l'eau connaît des mutations profondes dues principalement à la redéfinition du rôle de l'Etat dans ce secteur. Au Maroc, l'une des principales conséquences de cette réforme est l'émergence des associations des usagers des eaux agricoles. Cette institution qui oeuvre dans un cadre renouvelé aux structures informelles déjà en place, rencontre beaucoup de difficultés pour mener sa mission.
Cette recherche de type empirique essaye d'appréhender une meilleure compréhension de la dynamique des institutions de gestion de l'eau. Elle est menée au travers d'analyses croisées où un ensemble de disciplines convergent pour appréhender la gestion de l'eau. Elle commence, par une approche historique, à retracer le processus du développement de l'irrigation au Maroc. Elle s'intéresse ensuite au Ghiss qui par, son histoire, sa diversité complexe de gestion des ressources hydriques...
, constitue un laboratoire intéressant pour l'étude de la gestion sociale de l'eau. Le rôle des acteurs a permis d'analyser l'évolution des institutions relatives à la gestion de l'eau. Le maintien des acteurs locaux, malgré la tentative de domination des acteurs nationaux et supranationaux a montré la capacité de résistance des premiers. Ces réponses locales mettent en lumière la capacité de ces acteurs à initier des changements qui répondent aux aspirations locales tout en préservant les acquis du passé.
En même temps, ils essayent de s'adapter aux possibilités offertes par les changements en cours. La place que doit réserver l'Etat à ces initiatives est questionnée. Nous prônons un Etat facilitateur et négociateur plutôt qu'entrepreneur et administrateur, c'est dans ce sens que nous avons évoqué le nouveau concept "d'indifférence positive e l'Etat" . L'information qualitative recueillie ainsi que le modèle théorique sont utilisés pour réaliser un exercice de prospective.
Celui-ci permet de montrer l'existence de plusieurs facteurs susceptibles d'entraîner un échec de cette transition institutionnelle. Quelques mesures permettant de limiter ce risque sont recommandées.
Cette recherche de type empirique essaye d'appréhender une meilleure compréhension de la dynamique des institutions de gestion de l'eau. Elle est menée au travers d'analyses croisées où un ensemble de disciplines convergent pour appréhender la gestion de l'eau. Elle commence, par une approche historique, à retracer le processus du développement de l'irrigation au Maroc. Elle s'intéresse ensuite au Ghiss qui par, son histoire, sa diversité complexe de gestion des ressources hydriques...
, constitue un laboratoire intéressant pour l'étude de la gestion sociale de l'eau. Le rôle des acteurs a permis d'analyser l'évolution des institutions relatives à la gestion de l'eau. Le maintien des acteurs locaux, malgré la tentative de domination des acteurs nationaux et supranationaux a montré la capacité de résistance des premiers. Ces réponses locales mettent en lumière la capacité de ces acteurs à initier des changements qui répondent aux aspirations locales tout en préservant les acquis du passé.
En même temps, ils essayent de s'adapter aux possibilités offertes par les changements en cours. La place que doit réserver l'Etat à ces initiatives est questionnée. Nous prônons un Etat facilitateur et négociateur plutôt qu'entrepreneur et administrateur, c'est dans ce sens que nous avons évoqué le nouveau concept "d'indifférence positive e l'Etat" . L'information qualitative recueillie ainsi que le modèle théorique sont utilisés pour réaliser un exercice de prospective.
Celui-ci permet de montrer l'existence de plusieurs facteurs susceptibles d'entraîner un échec de cette transition institutionnelle. Quelques mesures permettant de limiter ce risque sont recommandées.