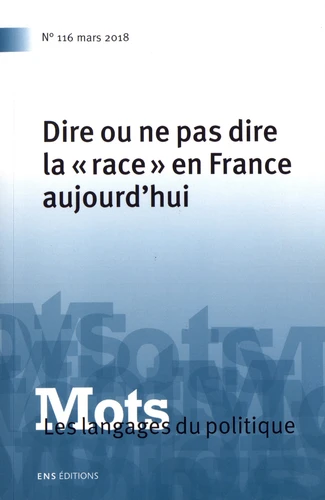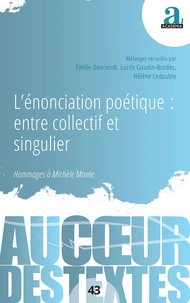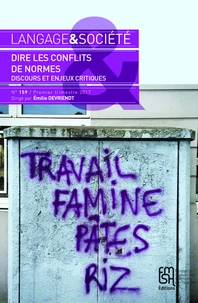Mots, les langages du politique N° 116, mars 2018
Dire ou ne pas dire la "race" en France aujourd'hui
Par : , , Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 26 juillet et le 1 aoûtCet article sera commandé chez un fournisseur et sera expédié 6 à 12 jours après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 26 juillet et le 1 août
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages176
- PrésentationBroché
- FormatGrand Format
- Poids0.286 kg
- Dimensions15,0 cm × 23,0 cm × 1,0 cm
- ISBN979-10-362-0000-7
- EAN9791036200007
- Date de parution17/03/2018
- ÉditeurENS (Editions)
Résumé
Il peut sembler paradoxal de trouver, dans bon nombre de discours publics contemporains invoquant des valeurs républicaines et universalistes, des stéréotypes stigmatisant ou valorisant des groupes de personnes en raison de leur apparence et/ou de leur culture, religion, ou mode de vie supposés, que le mot race soit employé ou non. Ce constat rejoint le "dilemme français" évoqué par plusieurs chercheurs pour souligner la contradiction entre la banalisation du référentiel racial dans l'espace public français et le modèle républicain classique aveugle à la situation minoritaire de groupes sociaux racisés.
L'usage de catégories "raciales" (qu'il s'agisse de l'emploi du mot race ou de l'activation du concept) fait également débat lorsqu'il est attesté dans des discours visant explicitement à combattre le racisme à des fins de lutte contre les discriminations (discours institutionnels ou militants) et/ou de revendication identitaire (discours de l'antiracisme dit politique). On touche là le "paradoxe racial" déjà signalé, qui consiste à reconnaître l'inexistence - avérée - de races humaines, tout en utilisant des catégories "raciales" pour décrire un processus social de racialisation aux effets également avérés.
Les contributions du dossier analysent à la fois comment se dit ou ne se dit pas la "race" dans certains discours politiques et médiatiques. Ce faisant, elles posent à nouveaux frais la question de savoir pourquoi dire ou ne pas dire la "race" en France aujourd'hui, et au-delà incitent à se demander si un discours antiraciste - scientifique ou militant - le doit ou le devrait.
L'usage de catégories "raciales" (qu'il s'agisse de l'emploi du mot race ou de l'activation du concept) fait également débat lorsqu'il est attesté dans des discours visant explicitement à combattre le racisme à des fins de lutte contre les discriminations (discours institutionnels ou militants) et/ou de revendication identitaire (discours de l'antiracisme dit politique). On touche là le "paradoxe racial" déjà signalé, qui consiste à reconnaître l'inexistence - avérée - de races humaines, tout en utilisant des catégories "raciales" pour décrire un processus social de racialisation aux effets également avérés.
Les contributions du dossier analysent à la fois comment se dit ou ne se dit pas la "race" dans certains discours politiques et médiatiques. Ce faisant, elles posent à nouveaux frais la question de savoir pourquoi dire ou ne pas dire la "race" en France aujourd'hui, et au-delà incitent à se demander si un discours antiraciste - scientifique ou militant - le doit ou le devrait.
Il peut sembler paradoxal de trouver, dans bon nombre de discours publics contemporains invoquant des valeurs républicaines et universalistes, des stéréotypes stigmatisant ou valorisant des groupes de personnes en raison de leur apparence et/ou de leur culture, religion, ou mode de vie supposés, que le mot race soit employé ou non. Ce constat rejoint le "dilemme français" évoqué par plusieurs chercheurs pour souligner la contradiction entre la banalisation du référentiel racial dans l'espace public français et le modèle républicain classique aveugle à la situation minoritaire de groupes sociaux racisés.
L'usage de catégories "raciales" (qu'il s'agisse de l'emploi du mot race ou de l'activation du concept) fait également débat lorsqu'il est attesté dans des discours visant explicitement à combattre le racisme à des fins de lutte contre les discriminations (discours institutionnels ou militants) et/ou de revendication identitaire (discours de l'antiracisme dit politique). On touche là le "paradoxe racial" déjà signalé, qui consiste à reconnaître l'inexistence - avérée - de races humaines, tout en utilisant des catégories "raciales" pour décrire un processus social de racialisation aux effets également avérés.
Les contributions du dossier analysent à la fois comment se dit ou ne se dit pas la "race" dans certains discours politiques et médiatiques. Ce faisant, elles posent à nouveaux frais la question de savoir pourquoi dire ou ne pas dire la "race" en France aujourd'hui, et au-delà incitent à se demander si un discours antiraciste - scientifique ou militant - le doit ou le devrait.
L'usage de catégories "raciales" (qu'il s'agisse de l'emploi du mot race ou de l'activation du concept) fait également débat lorsqu'il est attesté dans des discours visant explicitement à combattre le racisme à des fins de lutte contre les discriminations (discours institutionnels ou militants) et/ou de revendication identitaire (discours de l'antiracisme dit politique). On touche là le "paradoxe racial" déjà signalé, qui consiste à reconnaître l'inexistence - avérée - de races humaines, tout en utilisant des catégories "raciales" pour décrire un processus social de racialisation aux effets également avérés.
Les contributions du dossier analysent à la fois comment se dit ou ne se dit pas la "race" dans certains discours politiques et médiatiques. Ce faisant, elles posent à nouveaux frais la question de savoir pourquoi dire ou ne pas dire la "race" en France aujourd'hui, et au-delà incitent à se demander si un discours antiraciste - scientifique ou militant - le doit ou le devrait.