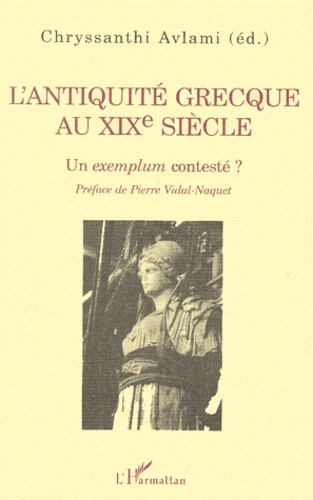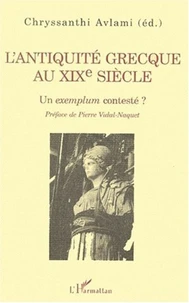L'Antiquité grecque au XIXème siècle.. Un exemplum contesté ?
Par :Formats :
- Paiement en ligne :
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 23 juillet et le 26 juilletCet article sera commandé chez un fournisseur et vous sera envoyé 3 à 6 jours après la date de votre commande.
- Retrait Click and Collect en magasin gratuit
- Livraison à domicile ou en point Mondial Relay entre le 23 juillet et le 26 juillet
- Réservation en ligne avec paiement en magasin :
- Indisponible pour réserver et payer en magasin
- Nombre de pages347
- PrésentationBroché
- Poids0.51 kg
- Dimensions13,5 cm × 21,4 cm × 2,4 cm
- ISBN2-7384-9857-4
- EAN9782738498571
- Date de parution13/01/2001
- CollectionLa philosophie en commun
- ÉditeurL'Harmattan
Résumé
L'histoire au XIXe siècle étant privée de sa fonction de magistra vitae (maîtresse de la vie), le monde grec ne constitue plus un modèle capable d'éclairer le présent en tant que dépositaire d'exemples incitant à l'imitation. Moment crucial pour la perception dix-neuvièmiste de la polis, la Révolution française fut aussi un moment de rupture. La question de l'imitation révolutionnaire du modèle gréco-romain n'a-t-elle pas fait couler tant d'encre, de Volney et de Benjamin Constant jusqu'à Fustel de Coulanges ? Hantée par l'avenir et le progrès, l'ère post-révolutionnaire a solidement inscrit l'entité grecque aux origines du trajet historique, qu'on a voulu sans faille, de la " civilisation occidentale " : si l'entité grecque est censée porter en germe ladite civilisation, elle n'en est pas moins vouée à refléter son état d'imperfection, son enfance (ou son adolescence). Dès lors, admiration et critique se relaient face à la Grèce. Cet effet de contraste ne lui assigne-t-il pas le statut d'exemple à contester ? Partagé entre ce qu'on peut, appeler un savoir grec de la politique et une politique du savoir grec, le XIXe siècle a produit des idées, au pluriel, du monde grec. Tenter de les rendre homogènes ne saurait peut-être se faire qu'au prix d'un artifice. Sans prétendre à l'exhaustivité, les études rassemblées dans ce volume entreprennent d'en exploiter quelques-unes, telles qu'on les trouve chez les penseurs politiques et les philosophes, les écrivains littéraires et les artistes, les traducteurs, les universitaires du XIXe siècle dont il est question ici. C.A.
L'histoire au XIXe siècle étant privée de sa fonction de magistra vitae (maîtresse de la vie), le monde grec ne constitue plus un modèle capable d'éclairer le présent en tant que dépositaire d'exemples incitant à l'imitation. Moment crucial pour la perception dix-neuvièmiste de la polis, la Révolution française fut aussi un moment de rupture. La question de l'imitation révolutionnaire du modèle gréco-romain n'a-t-elle pas fait couler tant d'encre, de Volney et de Benjamin Constant jusqu'à Fustel de Coulanges ? Hantée par l'avenir et le progrès, l'ère post-révolutionnaire a solidement inscrit l'entité grecque aux origines du trajet historique, qu'on a voulu sans faille, de la " civilisation occidentale " : si l'entité grecque est censée porter en germe ladite civilisation, elle n'en est pas moins vouée à refléter son état d'imperfection, son enfance (ou son adolescence). Dès lors, admiration et critique se relaient face à la Grèce. Cet effet de contraste ne lui assigne-t-il pas le statut d'exemple à contester ? Partagé entre ce qu'on peut, appeler un savoir grec de la politique et une politique du savoir grec, le XIXe siècle a produit des idées, au pluriel, du monde grec. Tenter de les rendre homogènes ne saurait peut-être se faire qu'au prix d'un artifice. Sans prétendre à l'exhaustivité, les études rassemblées dans ce volume entreprennent d'en exploiter quelques-unes, telles qu'on les trouve chez les penseurs politiques et les philosophes, les écrivains littéraires et les artistes, les traducteurs, les universitaires du XIXe siècle dont il est question ici. C.A.